De la longue correspondance du cinéaste François Truffaut qui a été publiée, la lettre la plus impressionnante et la plus violente, inhabituelle et inattendue de la part d’un homme au tempérament si doux, est celle envoyée à Jean-Luc Godard en mai-juin 1973, en réponse à une lettre de celui-ci.
A l’époque, les deux hommes se connaissent depuis près de vingt ans. Ils ont écumé les salles de cinéma parisiennes ensemble, ils ont aimé les mêmes films, ont tourné un court-métrage ensemble, Truffaut a donné le scénario d’A bout de souffle à Godard à l’époque où il tournait les 400 coups, qui lui offrit une consécration internationale, et lança véritablement le style de cinéma que les critiques allaient rassembler sous l’appellation de Nouvelle Vague. Truffaut et Godard ont eu une influence considérable sur le cinéma depuis les années 60. Cronenberg et Spielberg se réclament directement du premier, Tarantino et Soderbergh du second.
Alors que s’est-il passé en 1973 ? La lettre de Godard, envoyée au mois de mai de cette année, est une critique de La Nuit américaine, qui vient de sortir sur les écrans (il remportera l’oscar du meilleur film étranger). A propos de ce film qui raconte un tournage de cinéma de manière ludique, Godard accuse Truffaut de mentir sur la “vérité” des tournages, sur les rapports de force entre le metteur en scène et ses acteurs, ses producteurs, les techniciens, etc. Le plus révoltant est que Godard joint à l’insulte le mépris, en demandant à Truffaut dans le même courrier de coproduire un projet intitulé Un simple film, qui parlerait “véritablement” de cinéma.
La réponse de Truffaut est un règlement de compte et une claque à la figure de tous ceux qui ont la chance de faire du cinéma, mais qui en profitent pour mépriser ou méconnaître tout ce qui les a précédé, qui adoptent comme Truffaut le reproche à Godard “un comportement de merde sur son socle” avec leurs comédiens, leurs techniciens, les journalistes ou leurs producteurs. Il reproche à Godard de se victimiser (“les producteurs m’imposent des stars”) alors qu’il court après les vedettes de l’époque (Jane Fonda, Brigitte Bardot, etc.), de brandir le drapeau de la lutte des classes et d’être incapable de vendre La cause du peuple (journal interdit par l’Etat Français, vendu dans la rue par Sartre, Beauvoir et Truffaut au nom de la liberté d’expression), de sous-payer ses comédiens (notamment Jean-Pierre Léaud, fils spirituel de Truffaut) et de profiter de la culpabilité de jeunes producteurs de bonne famille : “Il y a encore à Paris assez de jeunes gens fortunés, complexés d’avoir eu leur première voiture à dix-huit ans, qui seront heureux de se dédouaner en disant : “je produis le prochain Godard”.
Bien sûr, cette lettre n’empêche pas d’apprécier les films de Godard, en particulier les oeuvres si lumineuses de la décennie 60 (comme la lettre de Godard ne doit pas empêcher d’aimer la poésie de La nuit américaine), mais elle devrait être affichée dans les toilettes de tous les aspirants cinéastes, pour qu’ils n’oublient jamais au moment où ils ont l’impression d’être les rois du monde sur quel auguste siège ils trônent.
Jean-Luc Godard à Truffaut, mai 1973
“J’ai vu hier La nuit américaine. Probablement personne ne te traitera de menteur, aussi je le fais. Ce n’est pas plus une injure que fasciste, c’est une critique, et c’est l’absence de critique où nous laissent de tels films, ceux de Chabrol, Ferreri, Verneuil, Delannoy, Renoir, etc., dont je me plains. Tu dis : les films sont de grands trains dans la nuit, mais qui prend le train, dans quelle classe, et qui le conduit avec le “mouchard” de la direction à côté ? Ceux-là aussi font les films-trains. Et si tu ne parles pas du Trans-Europ, alors c’est peut-être celui de banlieue, ou alors celui de Dachau-Munich, dont bien sûr on ne verra pas la gare dans le film-train de Lelouch. Menteur, car le plan de toi et de Jacqueline Bisset l’autre soir chez Francis n’est pas dans ton film, et on se demande pourquoi le metteur en scène est le seul à ne pas baiser dans La nuit américaine. Je suis en train de tourner en ce moment un truc intitulé Un simple film, il montre de manière simpliste (à ta manière, celle de Verneuil, Chabrol, etc.), qui fait aussi les films, et comment ces “qui” le font. Comment ta stagiaire numérote, comment le mec d’Eclair porte des sacs, comment le vieux de Publidécor peint les fesses du Tango, comment la standardiste de Rassam téléphone, comment la comptable de Malle aligne les chiffres, et chaque fois, on compare le son et l’image, le son du porteur et le son de Deneuve qu’il porte, le numéro de Léaud sur sa chaîne d’image, et le numéro de s/sociale de la stagiaire non payée, la dépense sexuelle du vieux de Publidécor et celle de Brando, le devis de la vie quotidienne de la comptable et le devis de La Grosse Bouffe, etc. A cause des ennuis de Malle et de Rassam qui produisent gros (comme toi), le fric qui m’était réservé a filé dans le Ferreri (c’est ça que je veux dire, on ne vous empêche pas de prendre le train, mais vous, si), et je suis en panne. Le film coûte environ 20 millions et est produit par Anouchka et TVAB Films (la société de Gorin et moi)?. Peux-tu entrer en coproduction pour 10 millions ? Pour 5 millions ? Vu La nuit américaine, tu devrais m’aider, que les spectateurs ne croient pas qu’on fait des films que comme toi. Tu n’es pas un menteur, comme Pompidou, comme moi, tu dis ta vérité. Je peux en échange, si tu veux, t’abandonner mes droits de La Chinoise, du Gai Savoir, de Masculin Féminin.
Si tu veux en parler, d’accord, Jean-Luc.
A Jean-Luc Godard, mai-juin 1973
Jean-Luc. Pour ne pas t’obliger à lire cette lettre désagréable jusqu’au bout, je commence par l’essentiel : je n’entrerai pas en coproduction dans ton film.
Deuxièmement, je te retourne ta lettre à Jean-Pierre Léaud : je l’ai lue et je la trouve dégueulasse. C’est à cause d’elle que je sens le moment venu de te dire, longuement, que selon moi tu te conduis comme une merde.
En ce qui concerne Jean-Pierre, si malmené depuis l’histoire de la grande Marie et plus récemment dans son travail, je trouve dégueulasse de hurler avec les loups, dégueulasse d’essayer d’extorquer, par intimidation, du fric à quelqu’un qui a quinze ans de moins que toi et que tu payais moins d’un million lorsqu’il était le centre de tes films qui t’en rapportaient trente fois plus.
Certes, Jean-Pierre a changé depuis Les 400 Coups, mais je peux te dire que c’est dans Masculin Féminin que je me suis aperçu pour la première fois que de se trouver devant une caméra pouvait lui apporter l’angoisse et non la joie. Le film était bon et lui était bon dans le film, mais la première scène, dans le café, était oppressante pour quelqu’un qui le regardait avec amitié et non comme un entomologiste.
Je n’ai jamais formulé la moindre réserve sur toi devant Jean-Pierre qui t’admirait tant, mais je sais que tu lui as souvent balancé des saloperies sur mon compte, à la manière d’un type qui dirait à un gosse : “alors, ton père, il se saoule toujours la gueule ?”
Jean-Pierre n’est pas le seul à avoir changé en 14 ans et si l’on projetait dans la même soirée A bout de souffle et tout va bien, le côté à la fois désenchanté et précautionneux du second créerait la consternation et la tristesse.
Je me contrefous de ce que tu penses de La nuit américaine, ce que je trouve lamentable de ta part, c’est d’aller, encore aujourd’hui, voir des films comme celui-là, des films dont tu connais d’avance le contenu qui ne correspond ni à ton idée du cinéma ni à ton idée de la vie. Est-ce que Jean-Edern Hallier écrirait à Daninos pour lui dire qu’il n’est pas d’accord avec son dernier livre ?
Tu as changé ta vie, ton cerveau, et, quand même, tu continues à perdre des heures au cinéma à t’esquinter les yeux. Pourquoi ? Pour trouver de quoi alimenter ton mépris pour nous tous, pour te renforcer dans tes nouvelles certitudes ?
A mon tour de te traiter de menteur. Au début de Tout va bien, il y a cette phrase : “Pour faire un film, il faut des vedettes.” Mensonge. Tout le monde connaît ton insistance pour obtenir J. Fonda qui se dérobait, alors que tes financiers te disaient de prendre n’importe qui. Ton couple de vedettes, tu l’as réuni à la Clouzot : puisqu’ils ont la chance de travailler avec moi, le dixième de leur salaire suffira, etc. Karmitz, Bernard Paul ont besoin de vedettes, pas toi, donc mensonge. La presse : on lui a “imposé” des vedettes… Autre mensonge, à propos de ton nouveau film : tu ne parles pas de la confortable avance sur recettes que tu as sollicitée, obtenue, et qui doit suffire même si Ferreri, comme tu l’en accuses drôlement, a dépensé l’argent qui t’était “réservé”. Alors, il se croit tout permis ce macaroni qui vient manger notre pain, ce travailleur immigré, il faut le reconduire à la frontière, via Cannes !
Tu l’as toujours eu, cet art de te faire passer pour une victime, comme Cayatte, comme Boisset, comme Michel Drach, victime de Pompidou, de Marcellin, de la censure, des distributeurs à ciseaux, alors que tu te débrouilles toujours très bien pour faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et surtout préserver l’image pure et dure que tu veux entretenir, fût-ce au détriment des gens sans défense, exemple Janine Bazin. Six mois après l’histoire Kiejman, Janine s’est vu supprimer ses deux émissions, vengeance habilement différée. Kiejman, n’envisageant pas de parler du cinéma politique sans t’interviewer, ton rôle à toi – il s’agit bien d’un rôle – consistait là encore à entretenir ton image subversive, d’où le choix d’une petite phrase bien choisie. La phrase est prononcée ; ou bien elle passe et elle est assez vive pour qu’on ne te soupçonne pas de mollir, ou bien elle ne passe pas et c’est épatant : décidément, Godard est toujours Godard, etc.
Tout se passe comme prévu, l’émission ne passe pas, tu restes sur ton socle. Personne ne relève que la phrase est un nouveau mensonge. Si Pompidou met en scène la France, toi, c’est le parti communiste et les syndicats que tu malmènes, sur le mode (trop indirect pour les “masses”) de la périphrase, de l’antiphrase et de la dérision, dans Tout va bien, film destiné, au départ, à la plus grande diffusion.
Si je me suis retiré du débat de Fahrenheit 451, à cette époque, c’était pour tenter d’aider Janine, pas par solidarité pour toi, c’est pourquoi je n’ai pas retourné le téléphone que tu m’as fait à ce moment.
Toujours est§il que le mois dernier, Janine était à l’hôpital, elle s’est fait renverser par une voiture au cours de sa dernière émission, opération du genou (elle boitait depuis l’adolescence, jerk, etc.) et elle se retrouve là, à l’hôpital, sans travail et sans fric et naturellement sans nouvelles de Godard qui ne descend de son socle que pour amuser Rassam de temps à autre. Alors je peux te dire : plus tu aimes les masses, plus j’aime Jean-Pierre Léaud, Janine Bazin, Patricia Finaly (elle sort de la clinique de sommeil, celle§là, et il faut harceler la cinémathèque pour obtenir ses six mois de salaire en retard), Helen Scott que tu rencontres dans un aéroport et à qui tu n’adresses pas la parole, pourquoi, parce qu’elle est américaine ou parce qu’elle est mon amie ? Comportement de merde. Une fille de la BBC t’appelle pour que tu parles de cinéma politique dans une émission sur moi, je la préviens d’avance que tu refuseras, mais mieux que ça, tu lui raccroches au nez avant de la laisser finir sa phrase, comportement élitaire, comportement de merde, comme lorsque tu acceptes de te rendre à Genève, Londres et Milan, et que tu n’y vas pas, pour étonner, pour surprendre, comme Sinatra, comme Brando, comportement de merde sur un socle.
Pendant une certaine période, après mai 68, on n’entendait plus parler de toi ou alors mystérieusement : il paraît qu’il travaille en usine, il a formé un groupe, etc., et puis, un samedi, on annonce que tu vas parler à RTL avec Monod. Je reste au bureau pour écouter, pour avoir de tes nouvelles en quelque sorte ; ta voix tremble, tu parais très ému, tu annonces que tu vas tourner un film intitulé La mort de mon frère, consacré à un travailleur noir malade qu’on a laissé mourir au sous-sol d’une fabrique de téléviseurs et, en t’écoutant, malgré le tremblement de la voix, je sens : 1, que l’histoire n’est pas exacte, en tout cas trafiquée ; 2 que tu ne tourneras jamais ce film. Je me dis : si le type avait une famille et que cette famille allait vivre désormais dans l’espoir que ce film soit fait ? Il n’y avait pas de rôle pour Montand là-dedans ni pour Jane Fonda, mais pendant 1/4 d’heure, tu as donné l’impression de te “conduire bien” comme Messmer quand il annonce le droit de vote à 19 ans. Fumiste. Dandy. Tu as toujours été un dandy, quand tu envoyais un télégramme à de Gaulle pour sa prostate, quand tu traitais Braunberger de sale juif au téléphone, quand tu traitais Chauvet de corrompu (parce qu’il était le dernier, le seul à te résister), dandy quand tu pratiques l’amalgame : Renoir-Verneuil, blanc bonnet et bonnet blanc, dandy encore aujourd’hui quand tu prétends que tu vas montrer la vérité sur le cinéma, ceux qui le font obscurément, mal payés, etc.
Quand tu faisais équiper un décor, garage ou boutique par les électros et que tu arrivais : “je n’ai pas d’idée aujourd’hui, on ne tourne pas”, et que les types déséquipaient, il ne t’est jamais venu à l’idée que les ouvriers se sentaient complètement inutiles et méprisés, comme l’équipe de son qui attendait vainement Brando dans l’auditorium vide à Pinewood, tout une journée ?
Maintenant, pourquoi est§ce que je te dis cela aujourd’hui et non pas il y a trois, cinq ou dix ans ?
Pendant six ans, comme tout le monde, je t’ai vu souffrir à cause d'(ou pour) Anna et tout ce qui était odieux en toi, on le pardonnait à cause de ta souffrance.
Je savais que tu avais entrepris Liliane Dreyfus (ex-David) en lui disant : “François ne t’aime plus, il est amoureux de Marie Dubois, qui joue dans son film”, et je trouvais ça pitoyable mais émouvant, oui, pourquoi pas, émouvant, à la limite ! Je savais que tu allais voir Braunberger en lui disant : “Faîtes-moi faire le sketch que Rouch doit tourner, à sa place” et je trouvais ça… disons, pathétique. Je me promenais avec toi sur les Champs-Elysées et tu me disais : “il paraît que Bébert et l’Omnibus ne marche pas, c’est bien fait” et je disais “Allons, allons…”.
A Rome, je me suis fâché avec Moravia parce qu’il m’a proposé de tourner Le Mépris, j’étais venu là, avec Jeanne, présenter Jules et Jim, ton dernier film ne marchait pas, Moravia voulait changer de cheval.
Pour les mêmes raisons de solidarité avec toi, je me suis fâché avec Melville qui ne te pardonnait pas de l’avoir aidé à faire Léon Morin prêtre, et qui cherchait à te nuire. A la même époque, tu humiliais Jeanne volontairement – ou pour faire plaisir à Anna (histoire d’Eva), tu tentais un dérisoire chantage sur Marie-France Pisier (Hossein, la Yougoslavie… à répétition… “l’alliance”), etc. Tu as fait tourner Catherine Ribeiro que je t’avais envoyée, dans Les Carabiniers, et puis tu t’es jeté sur elle, comme Charlot sur sa secrétaire dans Le Dictateur (la comparaison n’est pas de moi), j’énumère tout cela pour te rappeler de ne rien oublier dans ton film de vérité sur le cinéma et le sexe. Au lieu de montrer le cul de X… et les jolies mains d’Anne Wiazemsky sur la vitre, tu pourrais faire le contraire maintenant que tu sais que, pas seulement les hommes, mais les femmes aussi sont égales, y compris les actrices. Chaque plan de X… dans Week-end était un clin d’oeil aux copains : cette pute veut tourner avec moi, regardez bien comment je la traite : il y a les putes et les filles poétiques.
Je te parle de tout ça aujourd’hui parce que, tout de même, malgré le dandysme assombri d’un peu d’aigreur qui transparaissait encore dans certaines déclarations, je pensais que tu avais pas mal changé, je pouvais penser cela avant de lire la lettre destinée à Jean-Pierre Léaud. Si tu l’avais cachetée, peut-être as-tu voulu me donner une chance de ne pas la lui remettre ?
Aujourd’hui tu es fort, tu es censé être fort, tu n’es plus l’amoureux qui souffre, comme tout le monde tu te préfères et tu sais que tu te préfères, tu détiens la vérité sur la vie, la politique, l’engagement, le cinéma, l’amour, tout cela est bien clair pour toi et quiconque pense différemment est un salaud, même si tu ne penses pas en juin la même chose qu’en avril. En 1973, ton prestige est intact, c’est-à-dire que lorsque tu rentres dans un bureau, on regarde ton visage pour voir si tu es de bonne humeur ou s’il vaut mieux rester dans son coin ; parfois tu acceptes de rire ou de sourire ; le tutoiement a remplacé le vouvoiement, mais l’intimidation demeure, l’injure facile aussi, le terrorisme (cette façon de faire de la lèche à rebours). Je veux dire que je ne me fais pas de soucis pour toi, il y a encore à Paris assez de jeunes gens fortunés, complexés d’avoir eu leur première voiture à dix-huit ans, qui seront heureux de se dédouaner en disant : “je produis le prochain Godard.”
Quand tu m’as écrit, fin 68, pour me réclamer 8 ou 900 mille francs qu’en réalité je ne te devais pas (même Dussart était choqué !) et que tu as ajouté : “de toute façon, nous n’avons plus rien à nous dire”, j’ai pris tout ça au pied de la lettre ; je t’ai envoyé le fric et, hormis deux moments d’attendrissement (un sur moi malheureux en amour, un sur toi à l’hôpital), je n’ai plus rien éprouvé pour toi que du mépris, quand j’ai vu dans Vent d’est la séquence : comment fabriquer un cocktail Molotov et qu’un an plus tard, tu t’es dégonflé quand on nous a demandé de distribuer, pour la première fois, La Cause du peuple dans la rue…
L’idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi, elle n’est pas ressentie, c’est pourquoi tu ne parviens pas à aimer qui que ce soit, ni à aider qui que ce soit, autrement qu’en jetant quelques billets sur la table. Un type, genre Cavanna, a écrit : “il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie” et je n’ai jamais oublié comment tu te débarrassais des centimes en les glissant derrière les banquettes des bistrots. Contrairement à toi, je n’ai jamais prononcé une phrase négative à ton propos, à la fois parce que tu étais attaqué bêtement et plutôt ” à côté” des vraies choses, ensuite parce que j’ai toujours détesté les brouilles entre écrivains ou peintres, règlements de compte douteux par l’intermédiaire du papier journal, ensuite parce que je t’ai toujours senti à la fois jaloux et envieux, même dans tes bonnes périodes – tu es super compétitif, moi presque pas – et puis il y avait, de ma part, de l’admiration, j’ai l’admiration facile, tu le sais, et une volonté d’amitié depuis que tu t’étais attristé d’une phrase que j’avais dite à Claire Fischer à propos du changement de nos rapports après l’armée (pour moi) et la Jamaïque (pour toi). Je n




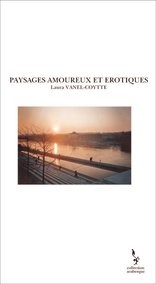




 Le style de vie est moderne : avion, voiture, loisirs de plein air... Sur un rythme de charleston, ces Années folles révèlent en même temps que les chevilles, puis les genoux, une mode cheveu court et chapeau cloche, taille basse et forme tubulaire… Au-delà de ces clichés, c’est l’avènement d’une mode libérée, facile à vivre.
Le style de vie est moderne : avion, voiture, loisirs de plein air... Sur un rythme de charleston, ces Années folles révèlent en même temps que les chevilles, puis les genoux, une mode cheveu court et chapeau cloche, taille basse et forme tubulaire… Au-delà de ces clichés, c’est l’avènement d’une mode libérée, facile à vivre.
 Faire vivre le vêtement sans le porter, qui plus est lui faire exprimer la folie malgré son immobilité n’est pas chose facile. Il nous a paru plus sûr de faire tourner, chercher, le visiteur ; lui donner l’envie, à travers la profusion d’une collection et un parcours complexe et labyrinthique, de trouver cette ivresse propre à la richesse de cette période. La présentation des oeuvres s’articule autour du paravent et du kiosque. Le paravent est lié au vêtement, on se réfugie derrière, on apparaît devant, c’est un écrin à taille humaine. Architecturalement, c’est un support en deux dimensions qui se développe dans l’espace, tout comme le tissu prend vie sur le volume du corps. Pour cette époque, c’est un élément qui rappelle la décomposition de l’espace, le cubisme et l’architecture modulaire. Il en va de même du kiosque, élément géométrique distinct, cellule autonome. Il a beaucoup été utilisé comme pavillon éphémère dans les expositions universelles, symbole de la boutique construite dans un but de représentation.
Faire vivre le vêtement sans le porter, qui plus est lui faire exprimer la folie malgré son immobilité n’est pas chose facile. Il nous a paru plus sûr de faire tourner, chercher, le visiteur ; lui donner l’envie, à travers la profusion d’une collection et un parcours complexe et labyrinthique, de trouver cette ivresse propre à la richesse de cette période. La présentation des oeuvres s’articule autour du paravent et du kiosque. Le paravent est lié au vêtement, on se réfugie derrière, on apparaît devant, c’est un écrin à taille humaine. Architecturalement, c’est un support en deux dimensions qui se développe dans l’espace, tout comme le tissu prend vie sur le volume du corps. Pour cette époque, c’est un élément qui rappelle la décomposition de l’espace, le cubisme et l’architecture modulaire. Il en va de même du kiosque, élément géométrique distinct, cellule autonome. Il a beaucoup été utilisé comme pavillon éphémère dans les expositions universelles, symbole de la boutique construite dans un but de représentation. La mode des années 20 consacre la libération du corps de la femme. Cette libération, dont Fortuny et Poiret sont les ardents défenseurs, se dessine en France dès le début du siècle, réactualisant le mouvement de réforme né en Angleterre vers 1880 ; les préraphaélites avaient tenté de transformer le vêtement et de supprimer le corset. En Autriche, la Sécession viennoise avait poursuivi le même objectif.
La mode des années 20 consacre la libération du corps de la femme. Cette libération, dont Fortuny et Poiret sont les ardents défenseurs, se dessine en France dès le début du siècle, réactualisant le mouvement de réforme né en Angleterre vers 1880 ; les préraphaélites avaient tenté de transformer le vêtement et de supprimer le corset. En Autriche, la Sécession viennoise avait poursuivi le même objectif. Le dancing. Ces années raffolent de la robe à danser qui accompagne le mouvement sans l’entraver. Décolletée, sans manches, elle est de forme droite dite tubulaire- l’aisance est donnée à partir de la taille abaissée au niveau des hanches par des astuces de coupe : quilles, panneaux flottants, fentes et franges. La sobriété de sa ligne contraste avec la richesse de son décor brodé de fils d’or, d’argent, de strass, de perles, de pierreries qui étincèlent de mille feux. Certaines de ces broderies dessinent des bijoux en trompe-l’oeil – sautoirs, ceintures… De 1925 - à l’apparition du charleston en France - à 1927, l’accélération des rythmes de la danse va de pair avec le raccourcissement de la robe pour atteindre le genou.
Le dancing. Ces années raffolent de la robe à danser qui accompagne le mouvement sans l’entraver. Décolletée, sans manches, elle est de forme droite dite tubulaire- l’aisance est donnée à partir de la taille abaissée au niveau des hanches par des astuces de coupe : quilles, panneaux flottants, fentes et franges. La sobriété de sa ligne contraste avec la richesse de son décor brodé de fils d’or, d’argent, de strass, de perles, de pierreries qui étincèlent de mille feux. Certaines de ces broderies dessinent des bijoux en trompe-l’oeil – sautoirs, ceintures… De 1925 - à l’apparition du charleston en France - à 1927, l’accélération des rythmes de la danse va de pair avec le raccourcissement de la robe pour atteindre le genou. L’influence du vestiaire masculin sur la garde-robe féminine. Le goût toujours plus affirmé de la femme moderne pour les tenues de sport contribue à estomper les frontières entre le vestiaire masculin et la garde-robe féminine. Dès 1923, hommes et femmes portent des chandails similaires. La cravate est si appréciée que l’on en fait des trompe-l’oeil en maille. La vogue du pyjama se répand vers 1923-1924. Sous un manteau d’intérieur, le pyjama est réservé à l’intimité. Les élégantes - en villégiature - l’adoptent rapidement comme tenue de plage. La haute couture crée des pyjamas de plus en plus raffinés.
L’influence du vestiaire masculin sur la garde-robe féminine. Le goût toujours plus affirmé de la femme moderne pour les tenues de sport contribue à estomper les frontières entre le vestiaire masculin et la garde-robe féminine. Dès 1923, hommes et femmes portent des chandails similaires. La cravate est si appréciée que l’on en fait des trompe-l’oeil en maille. La vogue du pyjama se répand vers 1923-1924. Sous un manteau d’intérieur, le pyjama est réservé à l’intimité. Les élégantes - en villégiature - l’adoptent rapidement comme tenue de plage. La haute couture crée des pyjamas de plus en plus raffinés. Les parfums et cosmétiques (cf. l’extrait du texte de Florence Muller p. 24). Reflets d’une mutation du mode de vie, les canons de la beauté changent. Il convient désormais d’être svelte et jeune pour être à la mode, le maquillage devient synonyme d’élégance. Crèmes de beauté et cosmétiques connaissent une véritable explosion, les marques rivalisent d’ingéniosité et déposent des brevets. La haute couture propose lignes de maquillage et parfums : en 1921 Chanel lance le N°5, en 1925 Guerlain commercialise Shalimar, Lanvin My Sin…
Les parfums et cosmétiques (cf. l’extrait du texte de Florence Muller p. 24). Reflets d’une mutation du mode de vie, les canons de la beauté changent. Il convient désormais d’être svelte et jeune pour être à la mode, le maquillage devient synonyme d’élégance. Crèmes de beauté et cosmétiques connaissent une véritable explosion, les marques rivalisent d’ingéniosité et déposent des brevets. La haute couture propose lignes de maquillage et parfums : en 1921 Chanel lance le N°5, en 1925 Guerlain commercialise Shalimar, Lanvin My Sin… Les styles mode et art. Les liens noués avant-guerre entre couturiers et artistes ou personnalités des Arts décoratifs tels Paul Poiret et Raoul Dufy se renforcent au cours des années 20 avec Jeanne Lanvin et Armand-Albert Rateau, Madeleine Vionnet et Ernesto Thayath, Charles Frédéric Worth ou Madame Agnès et Jean Dunand. Appliquant au textile ses recherches picturales tout comme celles de Robert Delaunay, Sonia Delaunay réalise en 1913 sa première robe «simultanée», assemblage de tissus de formes géométriques aux couleurs contrastées. Composition, couleurs et coupe sont liées. Le succès de ses créations l’amène à ouvrir son propre atelier sous l’enseigne «Sonia» et à déposer la marque «Simultané» en 1925. Elle édite ses premiers tissus imprimés. À l’Exposition de 1925, Sonia Delaunay présente avec Jacques Heim tenues, accessoires et tissus dans la «boutique simultanée» du pont Alexandre III. En 1926, elle dessine les costumes et les décors des films, Le Vertige de Marcel l’Herbier et Le P’tit Parigot de René Le Somptier. Entre 1922 et 1926 Natalia Gontcharova travaille pour la maison de couture Myrbor. Marqué par sa collaboration avec Diaghilev, son travail met en oeuvre applications et broderies aux couleurs vibrantes. Le décor lamé or d’une robe du soir, plus figuratif, relève de l’esthétique art déco. Myrbor présente des modèles à l’Exposition de 1925.
Les styles mode et art. Les liens noués avant-guerre entre couturiers et artistes ou personnalités des Arts décoratifs tels Paul Poiret et Raoul Dufy se renforcent au cours des années 20 avec Jeanne Lanvin et Armand-Albert Rateau, Madeleine Vionnet et Ernesto Thayath, Charles Frédéric Worth ou Madame Agnès et Jean Dunand. Appliquant au textile ses recherches picturales tout comme celles de Robert Delaunay, Sonia Delaunay réalise en 1913 sa première robe «simultanée», assemblage de tissus de formes géométriques aux couleurs contrastées. Composition, couleurs et coupe sont liées. Le succès de ses créations l’amène à ouvrir son propre atelier sous l’enseigne «Sonia» et à déposer la marque «Simultané» en 1925. Elle édite ses premiers tissus imprimés. À l’Exposition de 1925, Sonia Delaunay présente avec Jacques Heim tenues, accessoires et tissus dans la «boutique simultanée» du pont Alexandre III. En 1926, elle dessine les costumes et les décors des films, Le Vertige de Marcel l’Herbier et Le P’tit Parigot de René Le Somptier. Entre 1922 et 1926 Natalia Gontcharova travaille pour la maison de couture Myrbor. Marqué par sa collaboration avec Diaghilev, son travail met en oeuvre applications et broderies aux couleurs vibrantes. Le décor lamé or d’une robe du soir, plus figuratif, relève de l’esthétique art déco. Myrbor présente des modèles à l’Exposition de 1925.