 Louis XIV est un roi de France
Louis XIV est un roi de France , surnommé le Grand, baptisé sous les noms de Louis-Dieudonné, né à Saint-Germain-en-Laye
, surnommé le Grand, baptisé sous les noms de Louis-Dieudonné, né à Saint-Germain-en-Laye , le 5 septembre 1638, mort à Versailles
, le 5 septembre 1638, mort à Versailles , le 1er septembre 1715, fils aîné de Louis XIII et d'Anne d'Autriche.
, le 1er septembre 1715, fils aîné de Louis XIII et d'Anne d'Autriche.
Il n'avait pas cinq ans lorsque la mort de son père l'appela au trône (14 mai 1643). En dépit du testament du feu roi, Anne d'Autriche se fit déclarer par le parlement « régente pour en avoir la pleine autorité », c.-à-d. sans être obligée de régler ses actes de gouvernement sur les décisions d'un conseil que la prudente méfiance de Louis XIII avait prétendu lui imposer. Elle s'empressa d'ailleurs d'échapper à la cabale de ses anciens amis, les Importants, pour accorder tout pouvoir sur l'Etat au cardinal Mazarin, désigné par Richelieu comme le plus capable de conduire à bien les affaires extérieures.
Bien que le jeune roi ait été déclaré majeur aussitôt entré dans sa quatorzième année (1651), la première partie de son règne, jusqu'en 1661, se confond avec le ministère de Mazarin. La minorité de Louis XIV fut ainsi agitée au dedans par les troubles de la Fronde et signalée au dehors par des guerres avec l'empire et l'Espagne , qui ne furent terminées que par le traité conclu en 1649 avec l'empereur à Munster et par la paix des Pyrénées
, qui ne furent terminées que par le traité conclu en 1649 avec l'empereur à Munster et par la paix des Pyrénées , conclue en 1659 avec l'Espagne. Par ce dernier traité, Louis XIV épousa l'infante Marie-Thérèse d'Autriche
, conclue en 1659 avec l'Espagne. Par ce dernier traité, Louis XIV épousa l'infante Marie-Thérèse d'Autriche , fille du roi d'Espagne.
, fille du roi d'Espagne.
Il n'est pas exact de prétendre que le cardinal Mazarin ait négligé l'éducation du roi, qui le considérait « comme un père » (Voltaire). Mais cette éducation ne fut pas «-livresque ». Le roi fut progressivement initié à la connaissance des humains, au maniement des affaires. Il sut à qui il pouvait se fier, quels intrigants et quels ambitieux il devait écarter. Son mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, par les droits ou prétentions qui devaient en découler (1659), avait comme fixé à l'avance l'orientation de sa politique extérieure. Mazarin avait d'ailleurs reconnu dans son royal élève « l'étoffe de deux rois et d'un honnête homme ».
Le monarque absolu.
Après la mort de Mazarin (1661), Louis commença à régner par lui-même. Mazarin avait contribué à inspirer à Louis XIV la plus haute idée de ses droits et de ses devoirs de souverain. Cependant le goût excessif qu'il témoignait pour la chasse et pour la danse, pour les fêtes et pour les plaisirs, comme l'emportement de ses premières amours portaient à croire que Mazarin aurait un successeur, et la reine mère elle-même se livrait à cette illusion, même après que le roi eut annoncé au chancelier P. Séguier et à ses principaux conseillers sa résolution de gouverner par lui-même :
« Monsieur, je vous ai fait assembler avec mes ministres et mes secrétaires d'Etat, pour vous dire que jusqu'à présent j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par M. le cardinal. Je serai à l'avenir mon premier ministre. Vous m'aiderez de vos conseils lorsque je vous les demanderai. Je vous prie, Monsieur le chancelier, de ne rien sceller que par mes ordres, et vous, mes secrétaires d'Etat, de ne rien faire que par mon commandement. »
Ce ne furent pas de vaines paroles : la disgrâce et le procès criminel du surintendant Fouquet prouvèrent bientôt à tous que le nouveau maître ne le céderait à personne ni en vigueur de caractère, ni en lucidité d'esprit, ni en force de dissimulation. Mais il ne se contenta pas de gouverner par intermittence :
« Je m'imposai pour loi, écrit-il lui-même, de travailler régulièrement deux fois par jour, et deux ou trois heures chaque fois, avec diverses personnes, sans compter les heures que je passais seul en particulier, ni le temps que je pourrais donner extraordinairement aux affaires extraordinaires s'il en survenait, n'y ayant pas un moment où il ne fût permis de m'en parler, pour peu qu'elles fussent pressées. »
Ce gouvernement personnel, l'évolution de l'histoire de France depuis deux siècles environ en fit un gouvernement absolu et de droit divin. Louis XIV en expose ainsi les principes à son petit-fils :
depuis deux siècles environ en fit un gouvernement absolu et de droit divin. Louis XIV en expose ainsi les principes à son petit-fils :
« La France est un Etat monarchique dans toute l'étendue de l'expression. Le roi y représente la nation entière, et chaque particulier ne représente qu'un seul individu envers le roi. Par conséquent, toute puissance, toute autorité résident dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il établit [...]. La nation ne fait pas corps en France; elle réside tout entière dans la personne du roi. »
La propriété des biens fonciers ou même mobiliers ne dérive que d'une concession gracieuse du roi à ses sujets.
« Tout ce qui est dans le royaume vous appartient au même titre - dit-il à son héritier présomptif - et l'argent de votre cassette, et celui que vous voulez bien laisser dans le commerce de vos sujets. »
La puissance royale vient de Dieu , et ne dépend que de Dieu seul, sans nul intermédiaire, pas même le pape.
, et ne dépend que de Dieu seul, sans nul intermédiaire, pas même le pape.
« Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul d'examiner leur conduite. La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. »
Le for intérieur de la conscience religieuse n'est pas à l'abri des atteintes de cet universel despotisme qui valut à Louis XIV, de la part des Anglais et des Hollandais, le surnom de « Grand Turc très chrétien ». En théorie, et telle que Bossuet l'a doctrinalement décrite dans la Politique tirée de l'Écriture sainte, la monarchie de Louis XIV rappelle la monarchie de l'ancienne Perse , le Bas-Empire
, le Bas-Empire , les tsars, les sultans, mais avec beaucoup plus de raisonnements, d'argumentation politique et religieuse pour l'imposer, pour la faire valoir aux yeux d'une nation que son caractère et son histoire ne destinaient pas à la subir bien longtemps : surtout si la gloire, commune au roi et à la nation, venait à lui faire défaut. Aussi, en fait, l'absolutisme et la foi en l'absolutisme ont-ils, sous le règne de Louis XIV, suivi l'apogée ou le déclin de la force des armes, « qui sont journalières » (Mme de Sévigné). Mais l'orgueil du roi ne l'a jamais abandonné. Il était tel, dit le duc de Saint-Simon, que « sans la crainte du Diable
, les tsars, les sultans, mais avec beaucoup plus de raisonnements, d'argumentation politique et religieuse pour l'imposer, pour la faire valoir aux yeux d'une nation que son caractère et son histoire ne destinaient pas à la subir bien longtemps : surtout si la gloire, commune au roi et à la nation, venait à lui faire défaut. Aussi, en fait, l'absolutisme et la foi en l'absolutisme ont-ils, sous le règne de Louis XIV, suivi l'apogée ou le déclin de la force des armes, « qui sont journalières » (Mme de Sévigné). Mais l'orgueil du roi ne l'a jamais abandonné. Il était tel, dit le duc de Saint-Simon, que « sans la crainte du Diable que Dieu lui laissa jusque dans ses plus grands désordres, il se serait fait adorer et aurait trouvé des adorateurs ».
que Dieu lui laissa jusque dans ses plus grands désordres, il se serait fait adorer et aurait trouvé des adorateurs ».
Aucun souverain n'a réussi à faire passer aussi aisément, devant ses contemporains et devant certaine histoire, les scandales de sa vie privée et les excès de sa politique. Sa pleine et tranquille assurance pénétrait d'une majesté singulière ses actes et ses discours les plus insignifiants ou les plus ordinaires.
« Il n'avait ni la grâce chevaleresque de François ler, ni la séduisante familiarité de Henri IV. »
Mais il était toujours roi, à toute heure et dans les moindres choses :
« jetant sa canne par la fenêtre pour n'en point frapper un gentilhomme, supportant avec une égale dignité la joie, la colère, la douleur physique même, échappant par cette inaltérable majesté aux faiblesses de la nature humaine, il fut parfois odieux sans jamais être ridicule » (Prévost-Paradol).
- 
Louis XIV en majesté, par Rigaud (musée du Louvre).« Au milieu de tous les hommes - dit Saint-Simon qui tremblait au moment de lui parler - sa taille, son port, les grâces, la beauté et la grandeur même qui succéda à la beauté, jusqu'au ton de la voix et à l'adresse et à la grâce naturelle et majestueuse de sa personne, le faisaient distinguer jusqu'à la mort comme le roi des abeilles, »
« Il paraissait avec ce même air de grandeur et de majesté en robe de chambre jusqu'à n'en pouvoir soutenir les regards, comme dans la parure des fêtes et des cérémonies ou à cheval à la tête de ses troupes. »
Le développement de la cour, les minuties de l'étiquette, enfin la création de Versailles , ce temple de l'absolutisme, furent les conséquences naturelles de l'idée en quelque sorte religieuse que Louis XIV se fit de son pouvoir et de sa personne. Ce qui le met à part de la foule des despotes, c'est que, malgré sa vanité, il conserva le bon sens, la faculté « d'emprunter à autrui sans imitation et sans gêne », le tact et l'urbanité dans le choix et le maniement des gens : toutefois c'est aux recommandations suprêmes de Mazarin qu'il dut en partie, ne l'oublions pas, la collaboration des ministres éminents qui allaient former son premier conseil, entre autres le diplomate Hugues de Lionne et le financier, ou plutôt le ministre universel Jean-Baptiste Colbert.
, ce temple de l'absolutisme, furent les conséquences naturelles de l'idée en quelque sorte religieuse que Louis XIV se fit de son pouvoir et de sa personne. Ce qui le met à part de la foule des despotes, c'est que, malgré sa vanité, il conserva le bon sens, la faculté « d'emprunter à autrui sans imitation et sans gêne », le tact et l'urbanité dans le choix et le maniement des gens : toutefois c'est aux recommandations suprêmes de Mazarin qu'il dut en partie, ne l'oublions pas, la collaboration des ministres éminents qui allaient former son premier conseil, entre autres le diplomate Hugues de Lionne et le financier, ou plutôt le ministre universel Jean-Baptiste Colbert.
La vie privée de Narcisse.
Louis XIV n'était pas très beau, et son visage avait été marqué par la petite vérole; mais il avait des traits réguliers, des yeux expressifs et, malgré sa taille moyenne, une prestance vraiment royale. Il s'habillait richement, sans afféterie, d'habits commodes. Enfant, il n'avait aucune vivacité d'esprit, mais les connaisseurs avaient remarqué son air calme, qui dénotait une surprenante maturité. Sa qualité maîtresse paraît avoir été un certain bon sens, servi par une mémoire excellente et des habitudes régulières. Il lisait peu, mais savait écouter, et savait faire illusion en parlant bien de toutes choses. Il était poli avec exactitude et maître de ses émotions et de ses sentiments jusqu'à la dissimulation. Nul, mieux que lui, ne garda les secrets d'Etat et sépara mieux les affaires et les plaisirs.
La vie de cour.
Louis XIV a porté la vie de cour à son point de perfection. Il l'aimait, certes, car il y était incomparable et tout y tournait autour de sa personne comme les astres autour du Soleil ; mais ce profond calculateur y vit surtout I'avantage d'occuper sa noblesse et de lui rendre, sur ce brillant théâtre, le premier rang, qu'elle avait perdu dans le gouvernement. Rien, pour un peuple sociable et vain, ne console mieux de la nostalgie des grandes choses, qu'une vie mondaine réglée avec magnificence. Mais il fallait que le roi menât le jeu et fît mine au moins d'y attacher de l'importance. Louis XIV s'y donna de tout coeur et n'en dispensa personne. Et il sut si bien doser les moindres faveurs et s'intéresser à tout, que la vie de cour devint pour la noblesse française une chose délicieuse et la condition même de toute brillante carrière.
; mais ce profond calculateur y vit surtout I'avantage d'occuper sa noblesse et de lui rendre, sur ce brillant théâtre, le premier rang, qu'elle avait perdu dans le gouvernement. Rien, pour un peuple sociable et vain, ne console mieux de la nostalgie des grandes choses, qu'une vie mondaine réglée avec magnificence. Mais il fallait que le roi menât le jeu et fît mine au moins d'y attacher de l'importance. Louis XIV s'y donna de tout coeur et n'en dispensa personne. Et il sut si bien doser les moindres faveurs et s'intéresser à tout, que la vie de cour devint pour la noblesse française une chose délicieuse et la condition même de toute brillante carrière.
Seuls, quelques grincheux comprirent le machiavélisme du maître et s'enfermèrent dans leurs terres ou exhalèrent leur mauvaise humeur.. pour la postérité. La cour fut vraiment le centre de la France jusqu'à la fin du règne, et sauf à devenir moins attrayante lorsque le roi, définitivement rangé, imposa à tous la même sévérité de tenue et de parole. On vit mieux alors tout ce qu'elle avait d'artificiel, lorsqu'elle ne servit plus à couvrir les jeux éternels de la jeunesse et de l'amour.
jusqu'à la fin du règne, et sauf à devenir moins attrayante lorsque le roi, définitivement rangé, imposa à tous la même sévérité de tenue et de parole. On vit mieux alors tout ce qu'elle avait d'artificiel, lorsqu'elle ne servit plus à couvrir les jeux éternels de la jeunesse et de l'amour.
La vie de cour se résumait en une série de rites d'adulation autour de la personne du roi, auxquels il se prêtait, de son lever à son coucher, avec une complaisance qui surprend et révulse en même temps. Les grands officiers de la cour étaient les grands prêtres de ce culte; d'innombrables auxiliaires les assistaient, jaloux de leurs fonctions minuscules, qui leur permettaient d'approcher de la personne sacrée. Le lever, avec ses grandes et petites entrées, les audiences, le service divin, les repas, l'appartement, le coucher, se tenaient, selon un cérémonial minutieux, ainsi que les chasses, les collations dans les jardins, les promenades sur l'eau, les bals, les représentations théâtrales dans ces beaux décors de Fontainebleau , de Marly
, de Marly ou de Versailles
ou de Versailles .
.
Les satisfactions de vanité étaient le ressort principal de cette vie de cour, qui imposait, d'ailleurs, mille contraintes pénibles. Elle dressait à la dissimulation des sentiments les plus naturels. Le vrai courtisan, maître de son masque et de ses paroles, ne cherche qu'à plaire au roi par son attitude souriante et dégagée, par une flatterie spirituelle, par un raffinement inédit dans son empressement à servir. Le maître n'aime ni la fermeté, ni l'indépendance de caractère. Si séduisante qu'elle soit par ses dehors, la vie de cour a favorisé trop d'intrigants et n'a pas contribué à élever les âmes. Elle a aidé aussi au dérèglement des moeurs, en proposant aux meilleures familles de France , comme un but de vile ambition, l'exceptionnelle fortune des favorites du roi. Elle a développé, enfin, la passion du jeu avec toutes les dérives qui l'accompagnent. On jouait gros jeu à la cour, et si quelques habiles en vivaient. d'autres, plus nombreux, y dissipaient le patrimoine des ancêtres, base d'une légitime influence locale dont on ne savait plus le prix.
, comme un but de vile ambition, l'exceptionnelle fortune des favorites du roi. Elle a développé, enfin, la passion du jeu avec toutes les dérives qui l'accompagnent. On jouait gros jeu à la cour, et si quelques habiles en vivaient. d'autres, plus nombreux, y dissipaient le patrimoine des ancêtres, base d'une légitime influence locale dont on ne savait plus le prix.
Des affaires troubles, comme l'affaire des poisons, qui éclata au plus beau moment du règne, jettent un jour inquiétant sur les dessous d'une société si brillante. Cet attrait pour les devins, sorciers et magiciens, ces empoisonnements, ces avortements, révèlent, au moins dans certains milieux, un état de déséquilibre et de vertige. Si la Brinvilliers, la Voisin et leurs comparses n'eurent pas la clientèle étendue dont ils se réclamèrent et qui effara le lieutenant de police La Reynie, il subsistait dans le monde de la cour assez de ferments de scandales pour troubler un roi qui, malgré ses faiblesses, se souciait des apparences et détesta toujours la dépravation.
La famille légitime.
Louis XIV, né en 1638, avait épousé, en 1660, on l'a dit, l'infante Marie-Thérèse d'Autriche , du même âge que lui. La reine était insignifiante : elle partageait sa vie entre la dévotion, le jeu, où elle perdait sans cesse, et des divertissements importés de la cour d'Espagne
, du même âge que lui. La reine était insignifiante : elle partageait sa vie entre la dévotion, le jeu, où elle perdait sans cesse, et des divertissements importés de la cour d'Espagne , avec des bouffons et des petits chiens. Le roi la traita toujours avec les plus grands égards, mais il afficha tranquillement ses liaisons et n'admit jamais de remontrances. La reine, qui l'aimait et I'admirait, puisqu'on ne laissait d'autre choix, se résigna à fermer les yeux. Elle mourut en 1683; de ses nombreux enfants, un seul survécut, l'aîné, Louis, dit le Grand Dauphin, né en 1661. Ce prince, intellectuellement médiocre, avait fait le désespoir du duc de Montausier, son gouverneur, et de Bossuet, son précepteur. Il n'avait de goût que pour la chasse et montrait pour les affaires une entière apathie. Son père ne l'aimait pas. Marié, en 1679, à une princesse de Bavière
, avec des bouffons et des petits chiens. Le roi la traita toujours avec les plus grands égards, mais il afficha tranquillement ses liaisons et n'admit jamais de remontrances. La reine, qui l'aimait et I'admirait, puisqu'on ne laissait d'autre choix, se résigna à fermer les yeux. Elle mourut en 1683; de ses nombreux enfants, un seul survécut, l'aîné, Louis, dit le Grand Dauphin, né en 1661. Ce prince, intellectuellement médiocre, avait fait le désespoir du duc de Montausier, son gouverneur, et de Bossuet, son précepteur. Il n'avait de goût que pour la chasse et montrait pour les affaires une entière apathie. Son père ne l'aimait pas. Marié, en 1679, à une princesse de Bavière prématurément disparue, il mourut en 1711, après une vie sans dignité, et ne laissa pas de regrets.
prématurément disparue, il mourut en 1711, après une vie sans dignité, et ne laissa pas de regrets.
Il avait eu trois fils; le second, Philippe d'Anjou , monta en 1700 sur le trône d'Espagne
, monta en 1700 sur le trône d'Espagne , et le troisième, le duc de Berry
, et le troisième, le duc de Berry , mourut en 1714. L'aîné, Louis, duc de Bourgogne
, mourut en 1714. L'aîné, Louis, duc de Bourgogne , qui naquit en 1682 reçut l'éducation de son gouverneur, le duc de Beauvilliers, et de Fénelon, son précepteur. Il devint pieux, laborieux, attentif à ses devoirs jusqu'au scrupule. Peu doué pour la guerre, semble-t-il, il montra pour les affaires d'heureuses dispositions. Et lorsqu'il devint héritier présomptif par la mort de son père, il fut l'espoir de ce petit cercle d'esprits distingués qui rêvaient de revenir aux traditions aristocratiques de la royauté. Il épousa, en 1697, Marie-Adélaïde de Savoie
, qui naquit en 1682 reçut l'éducation de son gouverneur, le duc de Beauvilliers, et de Fénelon, son précepteur. Il devint pieux, laborieux, attentif à ses devoirs jusqu'au scrupule. Peu doué pour la guerre, semble-t-il, il montra pour les affaires d'heureuses dispositions. Et lorsqu'il devint héritier présomptif par la mort de son père, il fut l'espoir de ce petit cercle d'esprits distingués qui rêvaient de revenir aux traditions aristocratiques de la royauté. Il épousa, en 1697, Marie-Adélaïde de Savoie , jeune femme charmante, qui fut une épouse parfaite et égaya beaucoup la vieillesse mélancolique du roi. L'un et l'autre moururent en 1712, à quelques jours de distance, d'une rougeole maligne. Ils ne laissaient qu'un fils, qui devait être Louis XV.
, jeune femme charmante, qui fut une épouse parfaite et égaya beaucoup la vieillesse mélancolique du roi. L'un et l'autre moururent en 1712, à quelques jours de distance, d'une rougeole maligne. Ils ne laissaient qu'un fils, qui devait être Louis XV.
Les favorites et les bâtards.
La lignée légitime de Louis XIV était ainsi tout près de défaillir; mais il lui restait une lignée assez drue de bâtards. Dès 1661, un an après son mariage, commence le règne des favorites. La première, Louise de La Vallière, devenue duchesse de Vaujours, d'une bonne famille de noblesse provinciale, était fille d'honneur de Madame. Elle était belle et sage, mais ne sut pas résister à l'amour du roi; elle y répondit avec une sincérité traversée de remords. Elle donna au roi cinq enfants; Mlle de Blois survécut seule et épousa le prince de Conti, neveu du grand Condé. Louise de La Vallière se retira, en 1674, aux Carmélites de la rue d'Enfer et finit sa vie dans la pénitence, sous le nom de soeur Louise de la Miséricorde.
Depuis 1666, elle était remplacée dans la faveur du roi par Athénaïs de Rochechouart , marquise de Montespan, qu'elle avait eu l'imprudence d'accueillir dans son intimité. La nouvelle favorite, qui appartenait à la haute noblesse, avait séduit le roi par son esprit et sa beauté hardie, qui contrastait avec la grâce un peu fragile de Louise de La Vallière. Sa liaison fut coupée d'orages où éclatait son caractère altier. Des nombreux enfants qu'elle eut, quatre survécurent Mlle de Nantes, mariée au duc de Bourbon; Mlle de Blois, mariée à Philippe d'Orléans; le duc du Maine
, marquise de Montespan, qu'elle avait eu l'imprudence d'accueillir dans son intimité. La nouvelle favorite, qui appartenait à la haute noblesse, avait séduit le roi par son esprit et sa beauté hardie, qui contrastait avec la grâce un peu fragile de Louise de La Vallière. Sa liaison fut coupée d'orages où éclatait son caractère altier. Des nombreux enfants qu'elle eut, quatre survécurent Mlle de Nantes, mariée au duc de Bourbon; Mlle de Blois, mariée à Philippe d'Orléans; le duc du Maine et le comte de Toulouse
et le comte de Toulouse .
.
Louis XIV, au cours de ces liaisons, d'ailleurs coupées de passades, abandonna toute vergogne et donna un instant le scandale d'avoir, presque en même temps, des enfants de la reine et de deux maîtresses, dont l'une était mariée. Suivant l'exemple de son aïeul, il légitima tous ses bâtards par lettres-patentes enregistrées au Parlement.
Au déclin de la faveur de Mme de Montespan, qui lutta jusqu'au bout avant de finir, elle aussi, dans la pénitence, le roi eut encore quelques brèves liaisons, notamment avec Mlle de Fontanges. Après 1681, les objurgations de Bossuet, ses sentiments religieux, l'inclinèrent à une vie plus régulière. Mais ce retour s'accompagna d'une passion nouvelle pour Françoise d'Aubigné, petite-fille du célèbre poète calviniste (Agrippa d'Aubigné), mais catholique de naissance et veuve depuis 1660 de Scarron. Sans fortune, mais insinuante, elle sut intéresser la reine à son sort, tandis que Mme de Montespan lui confiait l'éducation de ses enfants. Son esprit solide et sa beauté plurent au roi, qui érigea pour elle en marquisat la terre de Maintenon. Mais elle lui résista et réussit même à rapprocher le roi de la reine; à la mort de Marie-Thérèse, un mariage secret l'unit à Louis XIV.
Le roi, ainsi rentré dans la règle, s'appliqua à racheter par une grande sévérité les erreurs de son passé. On en voulut beaucoup à Mme de Maintenon d'une réforme qui assura au roi la dignité de sa vieillesse, mais qui déçut de vilains calculs. On l'a aussi rendue responsable du zèle que le roi montra contre les Protestants et les Jansénistes. Mêlée aux affaires de l'État par le roi lui-même, calculatrice et peut-être ambitieuse, elle se trouve associée aux erreurs et aux embarras de la fin du règne. Mais il serait injuste de méconnaître sa piété et de ridiculiser l'idée mystique qu'elle avait d'être destinée à assurer le salut du souverain. A la cour, elle vivait très simplement, s'occupant de bonnes oeuvres, et souvent rebutée par l'humeur du roi, que la vieillesse assombrissait. Elle trouvait quelque douceur à sa maison de Saint-Cyr, qu'elle avait fait fonder, en 1686, pour l'éducation des demoiselles nobles et qu'elle dirigeait avec application et bon sens. Elle s'y retira très dignement après la mort du roi et y mourut en 1719.
Les princes de sang.
Philippe d'Orléans, frère du roi, dit Monsieur, né en 1640, mourut en 1701. Il avait de la capacité, mais si peu de discrétion que son frère, qui l'aimait beaucoup, l'éloigna toujours du Conseil. Marié d'abord avec Henriette d'Angleterre , qui fut en coquetterie avec le roi et dont la mort foudroyante, en 1670, émut la cour et inspira magnifiquement Bossuet, il épousa en secondes noces la princesse Palatine, fille de l'électeur Palatin, franche et dévouée, mais libre de langage et de manières. Monsieur avait des habitudes efféminées et des moeurs dépravées. Son fils Philippe, duc de Chartres, le futur Régent, menait une existence libertine et affichait l'athéisme; après la mort du duc de Bourgogne, il devint le centre de l'opposition aristocratique. La duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle, cousine germaine du roi, mais plus âgée que lui, représentait à la cour une époque disparue. Sa passion pour Lauzun, courtisan parfait et parfait intrigant, troubla la fin d'une vie agitée et ne lui laissa que des déceptions.
, qui fut en coquetterie avec le roi et dont la mort foudroyante, en 1670, émut la cour et inspira magnifiquement Bossuet, il épousa en secondes noces la princesse Palatine, fille de l'électeur Palatin, franche et dévouée, mais libre de langage et de manières. Monsieur avait des habitudes efféminées et des moeurs dépravées. Son fils Philippe, duc de Chartres, le futur Régent, menait une existence libertine et affichait l'athéisme; après la mort du duc de Bourgogne, il devint le centre de l'opposition aristocratique. La duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle, cousine germaine du roi, mais plus âgée que lui, représentait à la cour une époque disparue. Sa passion pour Lauzun, courtisan parfait et parfait intrigant, troubla la fin d'une vie agitée et ne lui laissa que des déceptions.
1661-1715 : le règne de Louis XIV.
Profitant de la paix et secondé par ses habiles ministres, Louis XIV rétablit le commerce, diminua les impôts, fit fleurir les arts, réforma, l'administration et perfectionna la législation. En 1665, Philippe IV, père de la reine, étant mort, Louis réclama en vertu du droit de Dévolution, la Flandre et la Franche-Comté
et la Franche-Comté , comme indemnité de la dot de sa femme, dot qui n'avait jamais été payée; sur le refus qu'on fit de les lui livrer, il marcha sur la Flandre dont il prit toutes les villes en une seule campagne (1667); l'année suivante, il prit plus rapidement encore la Franche-Comté
, comme indemnité de la dot de sa femme, dot qui n'avait jamais été payée; sur le refus qu'on fit de les lui livrer, il marcha sur la Flandre dont il prit toutes les villes en une seule campagne (1667); l'année suivante, il prit plus rapidement encore la Franche-Comté . La Hollande
. La Hollande , l'Angleterre
, l'Angleterre et la Suède
et la Suède s'étant alors liguées contre lui avec l'Espagne
s'étant alors liguées contre lui avec l'Espagne , Louis XIV se vit obligé de renoncer à la Franche-Comté, mais il gardait la Flandre.
, Louis XIV se vit obligé de renoncer à la Franche-Comté, mais il gardait la Flandre.
Après s'être assuré de la neutralité de l'Angleterre, Louis XIV déclara en 1672 la guerre aux Hollandais, qui s'étaient précédemment joints à ses ennemis : la campagne fut ouverte avec de brillants succès par le roi en personne, suivi de Turenne et de Condé; c'est au début de cette campagne qu'eut lieu le célèbre passage du Rhin. Le roi d'Espagne , l'Empereur et l'électeur de Brandebourg
, l'Empereur et l'électeur de Brandebourg , que la puissance du monarque français épouvantait, se liguèrent alors contre lui (1674) et commencèrent une nouvelle guerre : Louis s'empara de nouveau de la Franche-Comté
, que la puissance du monarque français épouvantait, se liguèrent alors contre lui (1674) et commencèrent une nouvelle guerre : Louis s'empara de nouveau de la Franche-Comté , Turenne entra dans le Palatinat, qu'il mit à feu et à sang; Schomberg battit les Espagnols dans le Roussillon
, Turenne entra dans le Palatinat, qu'il mit à feu et à sang; Schomberg battit les Espagnols dans le Roussillon ; Condé défit le prince d'Orange à Senef; Duquesne gagna deux batailles navales contre Ruyter, qui périt dans la dernière. L'Angleterre étant venue se joindre à la coalition, Louis XIV offrit la paix : il signa, en 1678, le traité de Nimègue, qui lui assurait la Franche-Comté. C'est après ces succès que lui fut décerné le surnom de Grand.
; Condé défit le prince d'Orange à Senef; Duquesne gagna deux batailles navales contre Ruyter, qui périt dans la dernière. L'Angleterre étant venue se joindre à la coalition, Louis XIV offrit la paix : il signa, en 1678, le traité de Nimègue, qui lui assurait la Franche-Comté. C'est après ces succès que lui fut décerné le surnom de Grand.
La paix ne l'empêcha pas d'ajouter à la France Strasbourg
Strasbourg , bombardé pour avoir insulté le pavillon français, et Gênes
, bombardé pour avoir insulté le pavillon français, et Gênes dut également s'humilier devant Louis XIV (1685). Mais la révocation de l'édit de Nantes
dut également s'humilier devant Louis XIV (1685). Mais la révocation de l'édit de Nantes (1685) vint interrompre le cours de tant de prospérité : cet acte de rigueur fit sortir de France une foule de familles qui portèrent chez l'étranger leur industrie et leur fortune. Peu après se forma la ligue d'Augsbourg
(1685) vint interrompre le cours de tant de prospérité : cet acte de rigueur fit sortir de France une foule de familles qui portèrent chez l'étranger leur industrie et leur fortune. Peu après se forma la ligue d'Augsbourg (1686), par laquelle l'Empire, l'Espagne
(1686), par laquelle l'Empire, l'Espagne , l'Angleterre
, l'Angleterre , la Hollande
, la Hollande se coalisèrent de nouveau contre la France. La campagne s'ouvrit pour Louis XIV par des succès que contre-balança la perte de la bataille navale de La Hogue. Les années 1692, 1693 et 1694 furent signalées par la prise de Namur
se coalisèrent de nouveau contre la France. La campagne s'ouvrit pour Louis XIV par des succès que contre-balança la perte de la bataille navale de La Hogue. Les années 1692, 1693 et 1694 furent signalées par la prise de Namur et les victoires de Fleurus, de Steinkerque, de Nerwinde et de La Marsaille; mais Namur fut reprise par Guillaume à la fin de 1694, et, lasses d'hostilités inutiles, les puissances belligérantes conclurent le traité de Ryswyk (1697) : le roi abandonna ses dernières conquêtes, excepté Strasbourg. La mort de Charles II, roi d'Espagne, qui laissait sa couronne à Philippe, duc d'Anjou
et les victoires de Fleurus, de Steinkerque, de Nerwinde et de La Marsaille; mais Namur fut reprise par Guillaume à la fin de 1694, et, lasses d'hostilités inutiles, les puissances belligérantes conclurent le traité de Ryswyk (1697) : le roi abandonna ses dernières conquêtes, excepté Strasbourg. La mort de Charles II, roi d'Espagne, qui laissait sa couronne à Philippe, duc d'Anjou , petit-fils de Louis XIV, amena une nouvelle coalition, dirigée par le célèbre triumvirat d'Eugène. Ces années furent mêlées de succès et de revers; mais en 1704, les Français furent battus à Hochstett, en 1706 à Ramillies et à Turin
, petit-fils de Louis XIV, amena une nouvelle coalition, dirigée par le célèbre triumvirat d'Eugène. Ces années furent mêlées de succès et de revers; mais en 1704, les Français furent battus à Hochstett, en 1706 à Ramillies et à Turin , et ils perdirent les Pays-Bas et l'Italie
, et ils perdirent les Pays-Bas et l'Italie .
.
Enfin, en 1707, Berwick gagna en Espagne (
( L'Espagne au XVIIIe siècle
L'Espagne au XVIIIe siècle ) la victoire signalée d'Almanza
) la victoire signalée d'Almanza , et Duguay-Trouin battit les flottes ennemies dans plusieurs rencontres. Cependant Louis XIV, ayant éprouvé quelques revers l'année suivante, demanda la paix; on ne lui fit que des réponses dures et humiliantes, et il se vit forcé de continuer la guerre; elle ne fut pas heureuse : Villars fut vaincu à Malplaquet
, et Duguay-Trouin battit les flottes ennemies dans plusieurs rencontres. Cependant Louis XIV, ayant éprouvé quelques revers l'année suivante, demanda la paix; on ne lui fit que des réponses dures et humiliantes, et il se vit forcé de continuer la guerre; elle ne fut pas heureuse : Villars fut vaincu à Malplaquet par Marlborough et le prince Eugène (1709). Tout semblait perdu lorsque Vendôme gagna la victoire de Villaviciosa, qui rendit le trône d'Espagne à Philippe (1710), et Villars celle de Denain (1712); qui amena la paix d'Utrecht
par Marlborough et le prince Eugène (1709). Tout semblait perdu lorsque Vendôme gagna la victoire de Villaviciosa, qui rendit le trône d'Espagne à Philippe (1710), et Villars celle de Denain (1712); qui amena la paix d'Utrecht (1713) : par ce traité, Louis XIV conservait ses conquêtes (Alsace
(1713) : par ce traité, Louis XIV conservait ses conquêtes (Alsace , Artois
, Artois , Flandre
, Flandre , Franche-Comté
, Franche-Comté , Cerdagne
, Cerdagne , Roussillon
, Roussillon ). Il mourut deux ans après, le 1er septembre 1715, laissant la couronne à son arrière-petit-fils, Louis XV, qui n'était âgé que de 5 ans. Il avait perdu peu auparavant son fils, dit le Grand Dauphin, et son petit-fils, le duc de Bourgogne
). Il mourut deux ans après, le 1er septembre 1715, laissant la couronne à son arrière-petit-fils, Louis XV, qui n'était âgé que de 5 ans. Il avait perdu peu auparavant son fils, dit le Grand Dauphin, et son petit-fils, le duc de Bourgogne .
.
-
Le siècle de Louis XIV.
Il y a un paradoxe apparent dans le règne de Louis XIV. Ce roi étroit d'esprit en même temps qu'épris de lui-même, ruina le pays tant il dépensa sans compter pour sa gloire, mais, au final, réussit, à cause de cela même, à associer son nom à une période de grand épanouissement de la culture. Sous ce prince égocentrique, la gloire des lettres, des arts et du commerce s'unit à celle des armes; c'est alors en effet qu'ont brillé Condé, Turenne, Vauban, Luxembourg, Villars, Catinat, Duquesne et Duguay-Trouin; Colbert et Louvois; Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau, Bossuet et Fénelon; Lebrun, Lesueur, Girardon, Puget et Perrault; c'est alors que furent élevés l'Hôtel des Invalides , le Val-de-Grâce, les palais de Versailles
, le Val-de-Grâce, les palais de Versailles , de Trianon, de Marly
, de Trianon, de Marly , la colonnade du Louvre
, la colonnade du Louvre .
.
A cela s'ajoutent nombre de réformes, qui portent le plus souvent la marque de Colbert, qui ont laissé souvent, et quelle que soit la sévérité du jugement qu'on portera sur certaines d'entre elles, une profonde empreinte dans l'histoire de la France . Telles sont la réforme des impôts, la création du contrôle général (1665), la protection de l'agriculture, l'établissement des manufactures royales (les Gobelins
. Telles sont la réforme des impôts, la création du contrôle général (1665), la protection de l'agriculture, l'établissement des manufactures royales (les Gobelins , la Savonnerie, etc), le système industriel surnommé système protecteur ou colbertisme, la réduction des douanes intérieures, la prohibition du commerce sous pavillon étranger par le moyen du droit de fret et des tarifs de 1664 et de 1667, le développement des colonies par le moyen des compagnies maritimes (
, la Savonnerie, etc), le système industriel surnommé système protecteur ou colbertisme, la réduction des douanes intérieures, la prohibition du commerce sous pavillon étranger par le moyen du droit de fret et des tarifs de 1664 et de 1667, le développement des colonies par le moyen des compagnies maritimes ( Cavelier de la Salle), la construction de routes et canaux, la marine militaire recrutée par classes (1666 et 1668), la fondation des Académies, la codification progressive des lois et coutumes par l'ordonnance sur la procédure civile ou Code Louis (1667), ordonnance des eaux et forêts (1669), l'ordonnance criminelle (1670), l'ordonnance du commerce (1673), l'ordonnance de la marine (1684), l'abject Code des colonies ou Code noir
Cavelier de la Salle), la construction de routes et canaux, la marine militaire recrutée par classes (1666 et 1668), la fondation des Académies, la codification progressive des lois et coutumes par l'ordonnance sur la procédure civile ou Code Louis (1667), ordonnance des eaux et forêts (1669), l'ordonnance criminelle (1670), l'ordonnance du commerce (1673), l'ordonnance de la marine (1684), l'abject Code des colonies ou Code noir (1685), qui ne parut que deux ans après la mort de Colbert, mais fut préparé par ses soins, etc.
(1685), qui ne parut que deux ans après la mort de Colbert, mais fut préparé par ses soins, etc.
L'histoire a en somme confirmé l'expression de « siècle de Louis XIV » introduite par Voltaire. L'action personnelle de ce roi sur les lettres et les arts de son temps peut être diversement appréciée, mais elle n'est pas contestable. ll ne fit d'ailleurs que suivre ou plutôt reprendre la politique de patronage littéraire, artistique et scientifique inaugurée par Richelieu. Le clergé avait la feuille des bénéfices : les hommes de lettres, savants, artistes, etc., eurent la feuille des pensions. Elle fut établie en 1663, un peu trop d'après les préférences de Chapelain, qui se plaça en tête comme « le plus grand poète français qui ait jamais été et du plus solide jugement ».
» introduite par Voltaire. L'action personnelle de ce roi sur les lettres et les arts de son temps peut être diversement appréciée, mais elle n'est pas contestable. ll ne fit d'ailleurs que suivre ou plutôt reprendre la politique de patronage littéraire, artistique et scientifique inaugurée par Richelieu. Le clergé avait la feuille des bénéfices : les hommes de lettres, savants, artistes, etc., eurent la feuille des pensions. Elle fut établie en 1663, un peu trop d'après les préférences de Chapelain, qui se plaça en tête comme « le plus grand poète français qui ait jamais été et du plus solide jugement ».
Les grands noms de la littérature française, Molière, Corneille, Racine, Mézeray, etc., y sont associés aux illustrations de second ordre, Quinault, Ch. Perrault, et même aux abbés Colin et de Pure. Boileau n'y sera inscrit que plus tard. Les étrangers y sont nombreux et généralement bien choisis : Heinsius, Cassini (de Bologne ), Huygens, etc. Louis XIV anoblit Lully, Le Nôtre, Lebrun, Mansart, Mignard; Racine et Boileau reçurent le titre d'historiographes du roi. La forme des Académies permit «-d'embrigader les talents » (Rambaud) et de soumettre la république des lettres à une discipline toute monarchique. A partir de 1672, l'Académie française se réunit au Louvre
), Huygens, etc. Louis XIV anoblit Lully, Le Nôtre, Lebrun, Mansart, Mignard; Racine et Boileau reçurent le titre d'historiographes du roi. La forme des Académies permit «-d'embrigader les talents » (Rambaud) et de soumettre la république des lettres à une discipline toute monarchique. A partir de 1672, l'Académie française se réunit au Louvre : ses remerciements au roi sont significatifs :
: ses remerciements au roi sont significatifs :
« Qu'un roi ait assez aimé les lettres pour loger une académie dans sa propre maison, c'est ce que la postérité n'apprendra guère que parmi les actions de Louis le Grand. Il ne se contente pas de nous accorder sa protection toute-puissante : il veut nous attacher à titre de domestiques. Il veut que la majesté royale et les belles-lettres n'aient qu'un même palais. »
Lorsque l'Académie française se mit à décerner des prix d'éloquence et de poésie, elle donna comme invariable sujet l'éloquence du roi. On ne saurait imaginer quel amas d'inepties hyperboliques cet usage a enfanté. Racine lui-même présente sous un jour inattendu l'oeuvre du Dictionnaire :
« Tous les mots de la langue, toutes les syllabes nous paraissent précieuses, parce que nous les regardons comme autant d'instruments qui doivent servir à la gloire de notre auguste protecteur. »
On sait que le principal objet de l'Académie des Inscriptions fut d'abord, non d'en déchiffrer, mais d'en composer à l'honneur du roi. Parmi les sciences, le roi ne protège avec quelque suite que l'astronomie . Aux peintres, il impose l'autorité tyrannique de Lebrun, auquel Mignard a seul assez de dignité et de force pour résister; l'Académie française de Rome
. Aux peintres, il impose l'autorité tyrannique de Lebrun, auquel Mignard a seul assez de dignité et de force pour résister; l'Académie française de Rome fut menée à la façon d'un couvent ou d'une manufacture royale, surtout lorsqu'elle eut passé dans le département de Louvois. Pour Louis XIV, les Teniers sont des « magots ». Il ne conçoit et n'estime que le genre noble. Dans les lettres, La Fontaine est longtemps mis de côté, comme un irrégulier; lorsque Boileau affirme au roi que le bonhomme est le plus grand poète de son temps, le roi répond : «-Je ne le pensais pas ». Molière ne fait jouer Tartufe
fut menée à la façon d'un couvent ou d'une manufacture royale, surtout lorsqu'elle eut passé dans le département de Louvois. Pour Louis XIV, les Teniers sont des « magots ». Il ne conçoit et n'estime que le genre noble. Dans les lettres, La Fontaine est longtemps mis de côté, comme un irrégulier; lorsque Boileau affirme au roi que le bonhomme est le plus grand poète de son temps, le roi répond : «-Je ne le pensais pas ». Molière ne fait jouer Tartufe qu'à grand-peine, grâce à l'éloge du « monarque ennemi de la fraude ». Valet de chambre du roi, il sent tout ce que la protection officielle a de lourd et de dangereux :
qu'à grand-peine, grâce à l'éloge du « monarque ennemi de la fraude ». Valet de chambre du roi, il sent tout ce que la protection officielle a de lourd et de dangereux :
« Qui se donne à la cour se dérobe à son art. »
L'historien Mézeray ayant témoigné, sans doute sans le vouloir, quelque indépendance dans l'appréciation du passé, se voit supprimer la moitié de sa pension, et pourtant il «-portait ses feuilles à M. Perrault », chargé de les censurer. Un abbé Primi, Italien, est engagé à force de promesses à écrire une histoire de Louis XIV : le roi n'en est pas satisfait et met l'auteur à la Bastille : aussi l'Anglais Burnet, auquel la même besogne fut demandée moyennant une pension, se hâta de regagner son pays. En matière religieuse, il va sans dire que les décisions de l'Index et celles de la faculté de théologie sont ponctuellement suivies : c'est pourquoi en 1661 l'éloge de Descartes est interdit, et l'enseignement de sa philosophie reste proscrit en France
: aussi l'Anglais Burnet, auquel la même besogne fut demandée moyennant une pension, se hâta de regagner son pays. En matière religieuse, il va sans dire que les décisions de l'Index et celles de la faculté de théologie sont ponctuellement suivies : c'est pourquoi en 1661 l'éloge de Descartes est interdit, et l'enseignement de sa philosophie reste proscrit en France . Leibniz est exclu, comme Protestant, des faveurs royales; entre autres savants, l'édit du 22 octobre 1685 chassa de France Denis Papin et Nicolas Lémery; Désaguliers, Dollond, Jean-Henri Lambert sont fils de Calvinistes proscrits. Bref, la protection royale est capricieuse, égoïste, intolérante.
. Leibniz est exclu, comme Protestant, des faveurs royales; entre autres savants, l'édit du 22 octobre 1685 chassa de France Denis Papin et Nicolas Lémery; Désaguliers, Dollond, Jean-Henri Lambert sont fils de Calvinistes proscrits. Bref, la protection royale est capricieuse, égoïste, intolérante.
« Une chose qui juge ce régime, c'est que l'éclat des arts et des lettres se soutienne si peu de temps. Le siècle reste grand tant que Louis XIV est entouré d'hommes dont le talent était déjà né quand il commença à les protéger. Mais il ne naît pas de génies nouveaux. » (Rambaud).
La dernière grande oeuvre de littérature laïque, Athalie, est de 1691. Sauf les écrivains et orateurs d'église, et Saint-Simon, qui écrit dans l'ombre,
« on pourrait dire qu'il ne s'est pas écrit en France à partir de la paix de Ryswick une seule oeuvre de haute valeur littéraire. On peut faire la même observation pour les arts. » (Rambaud).
L'esprit, à quelque spécialité qu'il s'applique, ne vit que de liberté. C'est ce que l'on peut constater de la façon la plus précise par les dates des oeuvres dans le domaine de la pensée. Le despotisme a accompli son office ordinaire, en appauvrissant l'arbre dont il avait récolté les fruits. (H. Monin / HGP).
 |
En Bibliothèque. - Les Oeuvres de Louis XIV présentent toutes un caractère politique; ce sont principalement les Mémoires pour l'instruction du Dauphin, publiées en 1806 par De Gain-Montagnac (Paris, 2 vol. in-8); les Lettres aux princes de l'Europe, à ses généraux, à ses ministres, etc., recueillies par M. Rose, secrétaire du cabinet, avec des remarques par Morelli (Paris, 1755, 2 vol. in-12); les Lettres au comte de Briord, ambassadeur extraordinaire de S. M. Très Chrétienne auprès des Etats-Généraux, dans les années 1700-1701 (La Haye, 1728, in-12); la Correspondance avec M. Amelot, son ambassadeur en Portugal, 1685-1688 (Nantes, 1863, in-8); la Correspondance avec M. Amelot, son ambassadeur en Espagne, 1705-1709 (Paris, 1864, 2 vol. in-8); les Lettres de Louis XIV, du Dauphin et d'autres princes, adressées à Mme de Maintenon (Paris, 1822, in-8). Entre les ouvrages classiques qui ont été écrits sur ce règne, on distingue: le Siècle de Louis XIV, par Voltaire; l'Histoire de Louis XIV, par Pélisson; l'Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, par Lémontey; l'Administration de Louis XIV, par Chéruel, 1850. On trouve aussi de curieux détails dans les Mémoires de Saint-Simon. Entre les ouvrages classiques qui ont été écrits sur ce règne, on distingue: le Siècle de Louis XIV, par Voltaire; l'Histoire de Louis XIV, par Pélisson; l'Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, par Lémontey; l'Administration de Louis XIV, par Chéruel, 1850. On trouve aussi de curieux détails dans les Mémoires de Saint-Simon.
|
http://www.cosmovisions.com/LouisXIV.htm
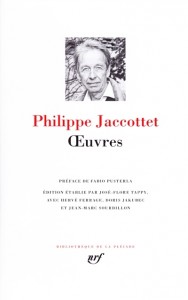














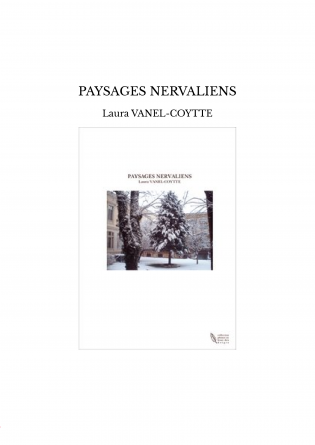
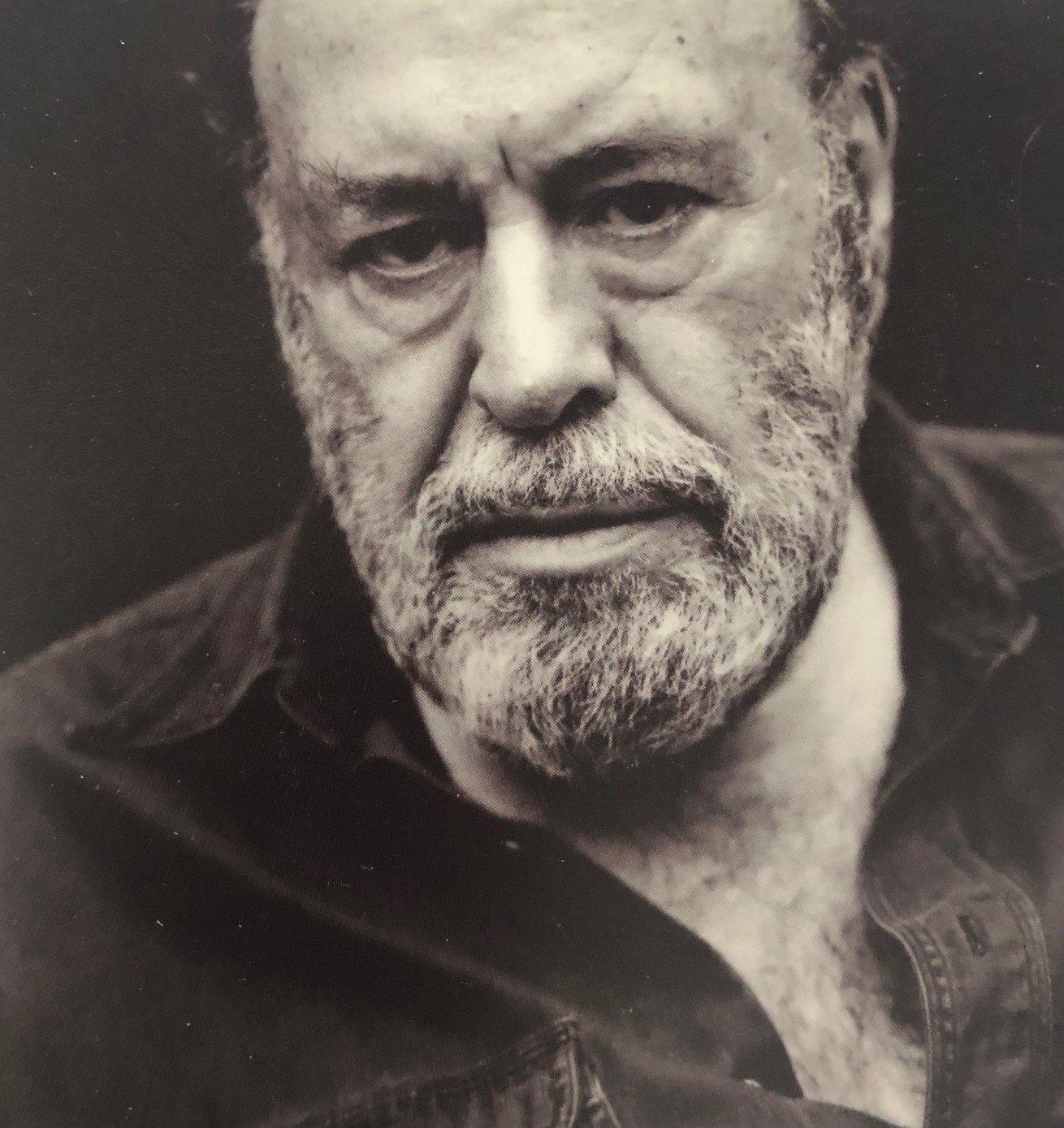


:quality(70):focal(1801x864:1811x874)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/IKBB3T2BC5CO3HZYEZHILWAH74.jpg)

























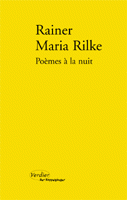

 Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius lors de son discours pour l'opération "Goût de France" au Château de Versailles. Il est entouré du chef Alain Ducasse (à gauche) et de Catherine Pégard, présidente de l'Etablissement public du château de Versailles dans la galerie des Batailles, jeudi 19 mars.
Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius lors de son discours pour l'opération "Goût de France" au Château de Versailles. Il est entouré du chef Alain Ducasse (à gauche) et de Catherine Pégard, présidente de l'Etablissement public du château de Versailles dans la galerie des Batailles, jeudi 19 mars. 
 Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, a reçu jeudi 19 mars à dîner 650 invités, dont plus de 90 ambassadeurs dans la galerie des Batailles, au Château de Versailles.
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, a reçu jeudi 19 mars à dîner 650 invités, dont plus de 90 ambassadeurs dans la galerie des Batailles, au Château de Versailles.