Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs
J'ai vu hier à la galerie Ceysson Benetière: Jim Peiffer
 Les expos comme tout ce que j'aime
Les expos comme tout ce que j'aime
inspire
ce que j'écris comme
"Paysages-marocains" à acheter ici
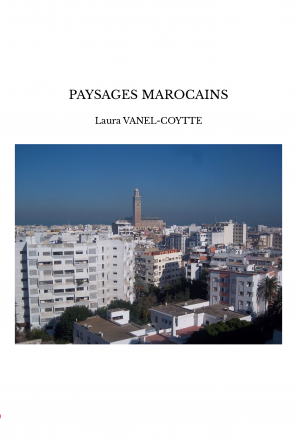
La galerie Ceysson & Bénétière est heureuse d'annoncer l'exposition de Jim Peiffer. Montres et Merveilles. La nécessité du fantastique. Né sous Saturne.
Vernissage le 4 mars 2023.
L’art de Jim Peiffer soulève bien des interrogations qu’après les avoir énoncées il faut ensevelir dans les brocantes des histoires. En face de ses œuvres, on a trop vite fait d’abuser de catégorisations postulant un art respectueux de normes sociétales, culturelles, esthétiques, crues définitivement établies par l’histoire de l’art qualifié, labellisé, mainstream. Ces catégorisations permettent toutes de définir des œuvres comme étant inside et d’autres outside de ce fameux mainstream.
Depuis l’attention accordée à un « art » populaire fait par des artistes vite baptisés « naïfs » et parfois « innocents », l’art des enfants et celui des fous ont très vite fait recette. Si l’on en croit Arthur Danto[1], ces catégorisations « appartiennent [...] à la nature même de la création artistique » et bien qu’elles suggèrent « un état d’exclusion [elles ne correspondent pas] à une frontière politique entre ceux des artistes » que le « monde de l’art » admet et ceux qu’il exclut. La qualité de leur art reconnue transcenderait, paraît-il, de possibles frontières.
C’est aller un peu vite en besogne. D’autant que Danto reconnaît que l’histoire de l’art moderne est une histoire d’appropriations. Cette histoire recoupe donc un brin celles des prédations colonialistes. Percevoir dans l’art primitif, comme le fit Picasso, un « pouvoir obscur » ne l’empêcha pas de s’en faire un « outil ». L’intérêt qu’après Klee, Dubuffet et tant d’autres, nous portons aujourd’hui, comme l’écrit Danto citant Roger Fry, à la « forme plastique expressive » d’œuvres faites par des artistes de communautés marginales, reléguées, relève quand même d’une discrimination politique que par une sorte de remords nous cherchons à exorciser. Et nous devons admettre aussi que l’on doit cesser d’associer de telles œuvres à des traitements et à des pédagogies défoulantes et participatives prétendument thérapeutiques aux intentionnalités parfois bien ambiguës. Mais l’art dit inside assure, lui aussi, parfois, de telles « missions » de réinsertion resocialisante...
L’artiste, on le sait, Francisco de Holanda nous en a prévenus bien avant Nelson Goodman, « fait » des mondes. Et plus il a su et pu peaufiner les moyens d’atteindre une parfaite mimésis de la Nature, plus il s’est employé à en corriger les imperfections. C’est-à-dire à corriger son Créateur ! Certains artistes nous en ont fait démonstration avec un excès maniériste les portant aux bords du gouffre.
Si certains portraits et paysages qu’il peint le sont sur un mode qui le situe dans la proximité de nombre d’artistes contemporains, Jim Peiffer éprouve comme une impérieuse nécessité le besoin de les mixer, de les fusionner, dans ses dessins surtout, dans une commune spatialité, ce que seule la surface d’une œuvre d’art permet. C’est-à-dire l’alliance unifiante dans une configuration formelle constituant, elle-même, en soi, une forme totalisante.
Il le fait surtout de deux façons. D’une part, ses formes et ses motifs sont cernés par des traits, des tracés, parfois secs et coupants – oscillant entre Artaud, Giacometti et Basquiat –, parfois épais et souples, affirmant par la netteté de leurs contours, leur présence pondérable dans un vide qu’ils peuplent jusqu’à l’emplir totalement. C’est ce que rendent sensible les « blancs » que Jim Peiffer nous donne à voir comme des « forces » régulant les encombrements et les placements des « objets » figurés. D’autre part, de mêmes formes et motifs soigneusement colorés, chaque zone de couleur bien délinéée, s’agrègent dans un espace comblé d’abord par la couleur, les couleurs, qu’il porte à cette dense et intense saturation digne des plus grands coloristes. Dans le premier cas, c’est la précision, ostensible, du rendu de formes voulues immuables comme celles fermement serties et découpées des figures prototypiques des icônes qui est privilégiée. Dans le second, ce sont des formes, elles aussi répétées mais cohabitantes, bien rangées, comme celles brillantes et émaillées que l’on voit dans les enluminures, selon l’ordonnancement du monde voulu par l’artiste, parti en aplats colorés, habité par des figures et des formes attestant de l’inventivité d’un imaginaire en permanente ébullition.
Les monstres s’y transmuent en merveilles et celles-ci en singularités qui ne redoutent pas l’humour, voire une causticité s’exerçant à l’égard de la réalité normale quotidienne. Celle-ci est renvoyée à ses démons dont la terrabilità est, elle, bien signalée car redoutée. Dresser l’inventaire de ce qui peuple ce fantastique où Jim Peiffer veut nous faire circuler n’est pas vraiment possible ici. Je conclurai par deux invites :
La première, dont j’ai posé les prémices, c’est de mettre cette œuvre en situation dans une histoire qui, à en faire le récit, nous ramènerait à la Préhistoire. Nous glisserions ensuite vers l’Antiquité, ses arts triviaux et sa dilection pour les métamorphoses, puis vers un Moyen Âge débordant de fatrasies, s’ébaudissant des hybridations zoomorphes les plus ahurissantes jusqu’aux folles diableries de Jheronimus Bosch. La Renaissance n’a pas échappé aux séductions de la « grotesque » réanimée de la Rome ancienne à partir de laquelle l’atelier de Raphaël, entre autres, sut improviser de savoureuses et subtiles ornementations. Et ça ne s’est pas arrêté jusqu’à la vogue invasive pour les arts discriminés de toutes les « primitivités » venant abonder – depuis surtout, les tocades maniaques pour d’exotiques paradis océaniens et africains, des Fauves, des Expressionnistes, des Cubistes – les innovations formelles et conceptuelles du modernisme et du postmodernisme.
La seconde, c’est de ne pas s’apeurer de la fréquence de l’œil-anus, de l’œil vulvaire, qui raccorde l’inventivité de Jim Peiffer à un thème dont l’art de la peinture ne peut se départir : celui de l’œil tétanisant, médusant, de la Gorgone mortelle. L’œil du Christ Pantocrator en est un avatar appelé à se laïciser. Nous ne regardons pas cette figure christique : c’est elle qui nous regarde. N’est-ce pas un peu cet œil que Buñuel fait trancher d’un aiguisé rasoir ?
L’oeil panoptique, l’oeil inquisiteur de tous les totalitarismes, cet oeil qui fait de tous les observés des choses, bref des déjections, des encombrants, dont il faut se débarrasser, se nettoyer pour qu’advienne un monde normalisé et « hygiénique », n’est-il pas la conséquence redoutable de l’œil trieur de l’Ancien des jours dans ses interprétations chrétiennes, catholiques et orthodoxes ? La récurrence de cet œil dans l’univers de Jim Peiffer est porteuse de ces signifiés de condamnations sans recours. Lui, il les retourne et les détourne, ces figures tout droit issues d’une mythologie prodigue en istorie facilitatrices de tous les renversements et déviations de sens exigés pour que puisse s’animer le théâtre du monde qu’il a obligation, selon lui, de reconfigurer. C’est pourquoi il accepte les visées médusantes comme un don bienfaisant à réactiver pour ce faire et à réarmer et retourner en un efficace boomerang à l’envoyeuse. Il se veut salvateur. Il se veut un peu notre Persée et son bouclier. Il veut nous préserver du regard de Méduse et de ses applications modernisées, mortifères et asservissantes, transformant notre réalité quotidienne en angoissants cauchemars hallucinogènes. Pourvues d’un œil sexué, armé et chargé d’une force vitale, ses figures, comme le fit le bouclier-miroir de Persée, reprojettent, répercutent, leur regard létal à la Méduse et à ses avatars séculiers. Les visées de ses figures défensives aspirent à conjurer le mauvais sort pouvant nous accabler, nous qui nous sommes arrêtés face à leur face. C’est pour nous préserver du malheur que, ses œuvres, Jim Peiffer les veut apotropaïques et consolatrices.
Vous avez dit outsider ?
Bernard Ceysson
[1] Arthur Danto, « L’art des outsiders », in La Madone du futur, Paris, Seuil, 2003, p. 335-342.
[2] Sylvie Deswarte, « Considérations sur l’artiste courtisan et le génie au XVIe siècle », in Jérôme de La Gorce, Françoise Levaillant et Alain Mérot, La Condition sociale de l’artiste XVIe-XXe siècle, oct. 1985, Paris, France ; Publications de l’université de Saint-Étienne, p. 13-28, 1987, halshs-01120854.
https://www.ceyssonbenetiere.com/fr/exhibitions/jim-peiffer-saint-etienne-acieries-2023-63b55ed91a/
Les expos comme tout ce que j'aime
inspire
ce que j'écris comme
"Paysages-marocains" à acheter ici