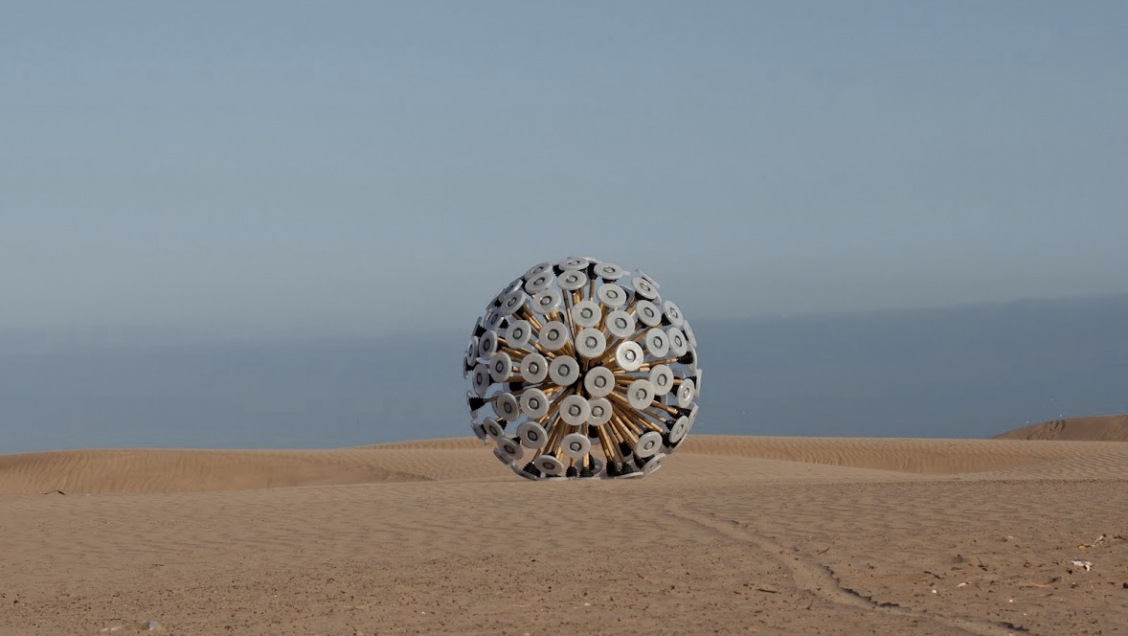Janice Hewlett Koelb. Poetics of Description. Imagined Places in European Literature. New York & Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2006, 232 pages.
Un malentendu critique lourd de conséquences ?
Tout commence avec une double interrogation : comment se fait-il que tout le monde emploie aujourd’hui le terme d’« ekphrasis » pour désigner des représentations verbales d’œuvres d’art, alors que ce terme grec a son origine dans une époque qui n’accordait aucun statut spécifique aux œuvres d’art ? Et est-ce que cette spécialisation sémantique n’a-t-elle pas eu pour résultat une vision réductrice et limitée de l’histoire de l’écriture descriptive ?
Afin de répondre à ces questions, Janice Koelb propose tout d’abord une utile mise au point de l’histoire du terme « ekphrasis ». Apparaissant pour la première fois au premier siècle avant notre ère, il est présent notamment dans les Progymnasmata, les exercices de rhétorique. Aelius Théon, au premier siècle de notre ère, définit l’ekphrasis comme « un discours qui nous fait faire le tour (periégèmatikos) de ce qu’il montre (to dèloumenon) en le portant sous les yeux avec évidence (enargôs) ».1 L’ekphrasis est liée avant tout à une certaine vivacité (enargeia chez les Grecs, puis evidentia chez les Romains) qui est censée transformer les lecteurs ou auditeurs en témoins. L’objet du discours ekphrastique n’est nullement restreint, pouvant porter sur des personnes, des lieux, des temps ou des ‘choses faites’ (pragmata), sans que les objets d’art soient expressément nommés. Koelb constate une remarquable stabilité de cette notion de l’ekphrasis depuis l’Antiquité au Moyen Âge et à la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle, stabilité due surtout aux manuels rhétoriques antiques qui continuent d’être utilisés à travers les siècles. C’est dans les Progymnasmata d’Aphtonius, traduits en latin et augmentés par Reinhold Lorich au XVIe siècle, que Milton a puisé son éducation rhétorique. Certes, à partir de la période hellénistique, l’œuvre d’art est valorisée en tant que telle et la description d’œuvres d’art peut ensuite devenir, dans les Eikones de Philostrate, un genre d’écriture à part. Avant cette période et dans beaucoup d’autres textes, cependant, ce n’est pas le cas, et on y trouve autant et plus de descriptions animées de lieux ou d’animaux que d’œuvres d’art.
Comment est-il possible, dans ce contexte, que le terme d’ekphrasis soit aujourd’hui limité à ne désigner que la représentation verbale d’une œuvre d’art ? Pourquoi les critiques ne citent que le bouclier d’Achille ou celui d’Énée comme des exemples représentatifs de l’ekphrasis classique ? Selon Janice Koelb, deux critiques français seraient les premiers qui, de manière hésitante, à la fin du XIXe siècle, auraient employés le terme d’ekphrasis pour désigner des descriptions d’art : Édouard Bertrand et Auguste Bougot, dans deux études sur Philostrate l’ancien parus en 1881.2 Lorsque Paul Friedländer, en 1912, dans son étude sur l’époque justinienne, insiste sur le fait que l’objet de l’ekphrasis n’était nullement limité à des œuvres d’art, c’est peut-être en réaction aux travaux de Bertrand et de Bougot.3 Et si l’Oxford Classical Dictionary semble autoriser, pour la première fois, en 1949, la définition restreinte de l’ekphrasis, ce n’est vraiment qu’avec le fameux article de Leo Spitzer sur l’« Ode to a Grecian Urn » de John Keats que cet usage du terme est consacré.4 Koelb note que si les critiques littéraires du XXe siècle avaient été aussi fascinés par l’histoire naturelle que par l’histoire de l’art, le sens restreint d’ekphrasis n’aurait peut-être pas eu le même succès. Mais c’est surtout parce que les « New Critics » anglo-saxons étaient acquis à l’idée du « poem as artifact » que la description d’une œuvre d’art les intéressait tant. Par un véritable renversement sémantique et axiologique, l’ekphrasis, qui avait désigné l’illusion d’immédiateté, était venu à désigner la représentation (verbale) d’une représentation (visuelle), l’image même de la médiation.5
La description éthique de lieux comme paradigme antique de l’ekphrasis
Selon Janice Koelb, la définition restreinte de l’ekphrasis a conduit la critique littéraire à négliger la tradition ekphrastique (ou descriptive) plus large et a détourné l’attention critique de descriptions « vives et animées » d’autre chose que d’objets d’art, occultant non seulement l’ekphrasis antique dans toute sa variété, mais également ses avatars ultérieurs. L’auteur entend donc rémédier à cette occultation en explorant une lignée ekphrastique négligée jusqu’ici, celle des descriptions de lieux. Elle se propose de montrer que c’est dans les descriptions de lieux entretenant un rapport figuratif avec un personnage que l’exigence de vivacité de l’ekphrasis, « the ancient topos of vividness » (p. 71), a perduré à travers les siècles. Loin d’être purement ornementales, ces descriptions sont fortement fonctionnalisées dans les textes : elles sont « integral to the design of the entire work » (p. 8) et appellent à une lecture allégorique (p. 54ff). Selon Koelb, c’est dès l’Antiquité que la description de lieux est le véritable paradigme de l’ekphrasis en tant que discours vif et animé. Koelb suggère que chez Homère et Virgile, l’enargeia des ekphrases est liée à ce qu’elles sont « interfused with (human or divine) character or feeling » (p. 14). L’auteur propose la paraphrase d’« ethical place description » pour ces ekphrases, l’épithète renvoyant au grec ethos, caractère. Cette tradition antique de la description de lieux a été transmise à la Renaissance, puis surtout à la poésie romantique anglaise dont elle représente une marque essentielle : « This study traces how the tradition of classical ekphrasis continued past antiquity into the modern world ; how its transformation after antiquity was particularly vigorous in the form of place description ; and how the poetry of Wordsworth and Byron was among the most successful and historically important offspring of that tradition ». (p. 17) C’est donc à une redécouverte de tout un pan de l’histoire de l’ekphrasis et à une relecture de la poésie romantique anglaise à la lumière de cette histoire que s’attache le livre de Janice Koelb.6
La tradition antique: Homère et Virgile fondateurs
Koelb entreprend dans un premier temps d’analyser les origines de la description de lieux à travers un exemple particulièrement significatif, celui de la longue description dans l’Énéide de Virgile, quand il décrit un paysage montagneux qui forme un havre naturel où Énée trouve refuge après une tempête devastatrice et avant de visiter le temple carthagénien. Cette description est elle-même la transformation d’une description homérique du havre consacré à Phorcys, en Ithaka, où Odysseus arrive à la toute fin de son périple. Dans une lecture aussi précise qu’ingénieuse du passage, s’appuyant notamment sur la métaphore de la paroi arborée (la « sylvan scene », p. 69) qui entoure le havre, Koelb montre que la description du havre répond à une stratégie virgilienne de l’enchâssement figuratif (« figurative embedding », p. 70) qui fait qu’elle s’intègre dans l’exposition du texte, soulève des questions et des attentes chez le lecteur, et établit des rapports de comparaison, de contraste, d’ironie même avec le reste du texte épique dans son ensemble.
Vers les romantiques anglais : Dryden et Milton passeurs
Dans deux textes de la fin du XVIIe siècle, la traduction de l’Éneíde par Dryden (1697) et Paradise Lost de Milton (1667), Koelb montre ensuite que la métaphore de la scène arborée virgilienne fonde tout une lignée de descriptions de paysages scéniques et pittoresques dans lesquels des sujets humains se trouvent être des spectateurs nostalgiques d’un monde des objets qu’ils ne sauraient pleinement habiter (p. 83). Au-delà d’une signification figurative ou symbolique du lieu pour le texte dans son ensemble, le lieu est maintenant, chez Milton notamment, décrit à travers la vision du personnage qui le découvre, et cette description est impregnée du caractère et de la situation de ce personnage : le Satan de Milton est incapable de percevoir la beauté du paradis, décrit avec tous les attributs du locus amœnus par le narrateur, parce qu’il porte l’enfer en lui-même et ne peut pas s’en échapper : entre la vision du paradis présenté par le narrateur (« the narrator’s illumined poetic vision », p. 89) et la perception que Satan a du même lieu, il y a un décalage qui reproduit l’opposition centrale du texte entre la conscience illuminée et la conscience après la chute, et est porteuse d’une ironie cruelle envers Satan. L’artificialité du paradis renvoie à l’idée du « divine artificer » et constitue un approfondissement du thème virgilien de la réalité et de l’illusion.
Ekphrasis et pittoresque : William Gilpin repoussoir
Si Milton, transformant la description virgilienne, a introduit dans l’histoire de la description de lieux le topos de l’interdépendance entre la nature et l’esprit humain, ce n’est cependant qu’au confluent d’un certain nombre de tendances, à la fin du dix-huitième siècle, que cette interdépendance a pu devenir poétiquement productive : des tendances en philosophie naturelle, en culture visuelle et théorie esthétique se réunissent et conditionnent la rhétorique descriptive (« descriptive rhetoric », p. 97) de Wordsworth. Koelb identifie comme catégorie esthétique centrale pour le développement de cette rhétorique descriptive la notion du pittoresque (« the picturesque », p. 97) telle qu’elle s’est développée au dix-huitième siècle dans le contexte d’une nouvelle manière de voyager pour le plaisir de regarder le paysage (« picturesque travel »). Elle a notamment été promue et théorisée, sous l’influence décisive de la théorie du beau et du sublime d’Edmund Burke et du Spectator de Joseph Addison, par William Gilpin.7 Koelb précise : « The entire project of picturesque travel was founded on the possibility of visiting nearby and partially familiar locations, but looking on these everyday scenes as if they were exotic, unfamiliar, and worthy of represenation in art. » (p. 97)
La théorie de Gilpin, taxinomique, rationalisante, prenant en considération les soucis pratiques du « middle-class traveler », fonctionne ici comme un repoussoir qui fait ressortir la singularité et le génie de William Wordsworth. Celui-ci réagit violemment contre Gilpin, transformant profondément le concept du « picturesque » tout en se l’appropriant : au lieu d’adopter un regard artificiel censé transformer la nature en œuvre d’art, il accentue l’idée qu’il importe surtout de prendre en compte l’homme percevant la nature pour évoquer, dans l’esprit du lecteur, « clear thoughts, lively images, and strong feelings », autrement dit, pour faire des descriptions de lieux vives et animées dans la tradition ekphrastique décrite par Koelb.
Les véritables héritiers de l’ekphrasis antique : Wordsworth et Byron
On sait que l’une des innovations de Wordsworth par rapport à ses prédécesseurs (les poètes de la nature, tels Young, Gray, Thomson, Philips), c’est d’avoir opéré un déplacement : de la description du lieu en tant que tel, il passe à celle de la perception du lieu par l’homme qui l’observe ou l’habite. Mais la transformation du « picturesque traveler » de Gilpin en une nouvelle figure, le « halted old wanderer » n’apparaît pleinement que dans le grand projet de The Excursion (1814) de Wordsworth que Koelb appelle une « antipicturesque excursion » (p. 134). Dans la première partie de The Excursion, intitulée « The Wanderer », tout se passe comme si Wordsworth avait pris le voyageur distrait et impatient de Gilpin pour le ralentir et lui permettre d’avoir une réaction émotionnelle face au lieu qu’il découvre, tout en montrant que les lieux sont eux-mêmes des emblèmes des humains qui s’y meuvent. Mais surtout, The Excursion devient, à travers les descriptions de lieux, un « therapeutic psychodrama » (p. 127) : le Wanderer et le poète visitent ensemble les alentours d’une maison où habitait jadis Margaret, dont le Wanderer raconte l’histoire au jeune poète. À travers les descriptions répétées de la maison de Margaret, le Wanderer crée les émotions qu’il convient de produire chez le poète qui l’écoute : l’histoire affligeante est tantôt figurée, tantôt contre-balancée par les descriptions pour permettre au poète de comprendre le sort tragique de Margaret sans lui-même perdre tout espoir, en créant une sorte de ‘Aufhebung’ descriptive. De cette manière, le lieu où le Wanderer et le poète sont assis, devient un « complex ethical place, filled with the fluctuating human character of its former inhabitant and its visitors, all of whom are in dialogue with each other and with the environment » (p. 153).8
Koelb clôt la série de ses interprétations par l’analyse de deux descriptions d’un même lieu, le Colisée à Rome, dans deux œuvres de Lord Byron, le « metaphysical drama » (dans les termes de Byron) Manfred (1817) and Childe Harold’s Pilgrimage (parties 3 et 4, 1816-18). Bien qu’elles représentent le lieu le plus caracéristique de la culture romaine et le moins caractéristique de Wordsworth, Byron le transforme, dans ces deux descriptions, en un « Wordsworthian emblem of mind » (p. 156). Koelb s’intéresse à ces descriptions, pour leur fonctionnement même, mais aussi dans leurs relations l’un avec l’autre, en tant qu’elles sont révélatrices de la relation entre Byron et Wordsworth. L’objectif de Koelb est de montrer comment l’« imagery » de Byron établit une « rhetorical-psychological connection » entre la suffrance mentale, l’expérience d’une fracture identitaire dans le paysage alpestre et l’expérience de repos que le héros byronique vit dans l’arène romaine (p. 160). Parlant de Manfred, Koelb écrit : « Under the night sky, the amphitheater modulates all Manfred’s extremes and integrates the opposites that tear him apart. Manfred’s rhetoric fully embodies Manfred’s potential ethos. His place description, as physical as is psychological, picks up the pieces of all the usual antinomies, fusing them into an emblem of the integration Manfred might have achieved. » (p. 170)
Bilan : une ekphrasis peut en cacher une autre
Outre l’ingéniosité des analyses détaillées des textes, les vastes connaissances déployées pour raconter cette histoire de la description des lieux, la ferme volonté de ne pas se laisser enfermer dans un discours critique établi, et, n’oublions pas de le dire, l’admirable maniement de la langue qui mêle réflexions sobres, commentaires et images poignantes,9 un des points forts du livre de Koelb, c’est l’impressionnante maîtrise des textes qui lui permet de montrer, avec une précision à laquelle il est impossible de faire justice ici, comment chaque description prend place et sens dans le texte dans son ensemble et comment elle se positionne vis-à-vis d’autres descriptions. La problématique choisie par Janice Koelb lui permet ainsi de proposer des relectures intéressantes des œuvres étudiées, notamment de celles de Wordsworth et de Byron.
Il ne faudrait pas oublier, cependant, que toutes ces relectures attentives et détaillées sont au service d’un projet ambitieux et, devrait-on presque dire, polémique dont le mérite est de jeter de la lumière sur une pratique descriptive importante et sur les liens que celle-ci entretient avec la tradition antique de l’ekphrasis. L’étude gagne son pari et réussit à nous révéler une « lignée » ekphrastique sinon insoupçonnée, du moins fortement occultée jusqu’ici par la lignée ekphrastique de la description de tableaux. Prenant toutes deux leur point de départ dans l’ekphrasis antique comme « discours qui met sous les yeux de manière vive et animée l’objet du discours », l’une s’est en quelque sorte spécialisée dans la représentation des œuvres d’art et dans la problématisation de la représentation et du rapport entre le texte et l’image. L’autre s’est tournée vers la représentation de lieux et a soulignée de plus en plus fortement l’interdépendance entre lieu et personnage pour devenir une figuration du sujet qui perçoit le lieu et qui en est en même temps affecté.
Le mérite et la réussite de cette polémique se font, certes, au prix d’une double cécité volontaire et peut-être nécessaire : d’une part, le lien entre l’ekphrasis comme discours suscitant des images et de l’ekphrasis comme discours sur des images est constamment minimisé, et dans les descriptions de lieux étudiées, toute allusion à la peinture est en quelque sorte désavouée. D’autre part, si une ekphrasis peut en cacher une autre, une restriction sémantique peut également en remplacer une autre : tout en plaidant pour une réouverture de la notion d’ekphrasis, le livre n’étudie pas l’ekphrasis en tant que discours vif et animé tout court, mais l’histoire de la description d’un lieu congruent avec l’état ou la situation d’un personnage : une poétique de l’immédiateté se transforme en une poétique de l’emblème de l’esprit, transformation dans laquelle Koelb souligne davantage les continuités que les ruptures. N’empêche que ce livre dense et érudit mérite toute notre attention.
Publié sur Acta le 20 décembre 2007