Recueil de poèmes en hommage aux deux auteurs
La Rose et le Réséda
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Nuit violente ô nuit dont l’épouvantable cri profond devenait
plus intense de minute en minute
Nuit qui criait comme une femme qui accouche
Nuit des hommes seulement
Une barque s'en va sur l'eau sur l'eau
Comme fait la feuille du saule
Comme ta joue à mon épaule
Comme la paupière à l'œil clos
Une barque s'en va sur l'eau sur l'eau
Comme fait la feuille du saule
La lente Loire passe altière et, d'île en île,
Noue et dénoue, au loin, son bleu ruban moiré ;
La plaine mollement la suit, de ville en ville,
Le long des gais coteaux de vigne et de forêt ;
Depuis l’âge orageux des aurores premières
Où tout un ciel pleuvait sur un monde naissant,
Suivi d’un infini cortège de rivières,
Au large, à plein chenal, en triomphe, il descend.
Ô de qui la vive course
Prend sa bienheureuse source,
D’une argentine fontaine,
Qui d’une fuite lointaine,
Te rends au sein fluctueux
De l’Océan monstrueux,
Loire, hausse ton chef ores
Bien haut, et bien haut encores,
Et jette ton oeil divin
Sur ce pays Angevin,
Le plus heureux et fertile,
Qu’autre où ton onde distille.
Bien d’autres Dieux que toi, Père,
Daignent aimer ce repaire,
A qui le Ciel fut donneur
De toute grâce et bonheur.
Quand quelquefois je pense à ma première vie
Du temps que je vivais seul roi de mon désir,
Et que mon âme libre errait à son plaisir,
Franche d'espoir, de crainte, et d'amoureuse envie :
Soleil je t’adore comme les sauvages
à plat ventre sur le rivage
Charles Baudelaire:"Bohémiens en voyage" dans "Les Fleurs du Mal."
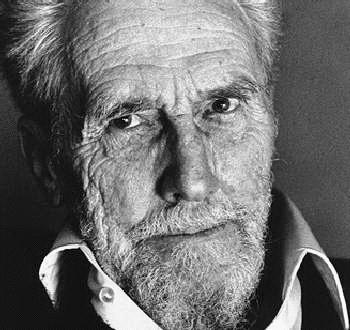 Ezra Pound.
Ezra Pound.
Reverrais-je jamais la Giudecca ?
ou les lumières qui la masquent, Ca’Foscari, Ca’ Giustinian
ou la Ca’, comme ils disent, de Desdémone
ou les deux tours qui n’ont plus leur cyprès
ou les bateaux amarrés devant la Zattere
ou le quai nord de la Sensaria DAKRUON DAKPYCON
et frère Gulpe se construit une belle maison
de quatre pièces, dont l’une a la forme d’un flacon d’alcool
Ainsi, mon cher, tu t'en reviens
Du pays dont je me souviens
Comme d'un rêve,
De ces beaux lieux où l'oranger
Naquit pour nous dédommager
Du péché d'Ève.
Tu l'as vu, ce ciel enchanté
Qui montre avec tant de clarté
Le grand mystère ;
Si pur, qu'un soupir monte à Dieu
Plus librement qu'en aucun lieu
Qui soit sur terre.
Tu les as vus, les vieux manoirs
De cette ville aux palais noirs
Qui fut Florence,
Plus ennuyeuse que Milan
Où, du moins, quatre ou cinq fois l'an,
Cerrito danse.
Tu l'as vue, assise dans l'eau,
Portant gaiement son mezzaro,
La belle Gênes,
Le visage peint, l'oeil brillant,
Qui babille et joue en riant
Avec ses chaînes.
Tu l'as vu, cet antique port,
Où, dans son grand langage mort,
Le flot murmure,
Où Stendhal, cet esprit charmant,
Remplissait si dévotement
Sa sinécure.
Tu l'as vu, ce fantôme altier
Qui jadis eut le monde entier
Sous son empire.
César dans sa pourpre est tombé :
Dans un petit manteau d'abbé
Sa veuve expire.
Tu t'es bercé sur ce flot pur
Où Naple enchâsse dans l'azur
Sa mosaique,
Oreiller des lazzaroni
Où sont nés le macaroni
Et la musique.
Qu'il soit rusé, simple ou moqueur,
N'est-ce pas qu'il nous laisse au coeur
Un charme étrange,
Ce peuple ami de la gaieté
Qui donnerait gloire et beauté
Pour une orange ?
Catane et Palerme t'ont plu.
Je n'en dis rien ; nous t'avons lu ;
Mais on t'accuse
D'avoir parlé bien tendrement,
Moins en voyageur qu'en amant,
De Syracuse.
Ils sont beaux, quand il fait beau temps,
Ces yeux presque mahométans
De la Sicile ;
Leur regard tranquille est ardent,
Et bien dire en y répondant
N'est pas facile.
Ils sont doux surtout quand, le soir,
Passe dans son domino noir
La toppatelle.
On peut l'aborder sans danger,
Et dire : " Je suis étranger,
Vous êtes belle. "
Ischia ! C'est là, qu'on a des yeux,
C'est là qu'un corsage amoureux
Serre la hanche.
Sur un bas rouge bien tiré
Brille, sous le jupon doré,
La mule blanche.
Pauvre Ischia ! bien des gens n'ont vu
Tes jeunes filles que pied nu
Dans la poussière.
On les endimanche à prix d'or ;
Mais ton pur soleil brille encor
Sur leur misère.
Quoi qu'il en soit, il est certain
Que l'on ne parle pas latin
Dans les Abruzzes,
Et que jamais un postillon
N'y sera l'enfant d'Apollon
Ni des neuf Muses.
Il est bizarre, assurément,
Que Minturnes soit justement
Près de Capoue.
Là tombèrent deux demi-dieux,
Tout barbouillés, l'un de vin vieux,
L'autre de boue.
Les brigands t'ont-ils arrêté
Sur le chemin tant redouté
De Terracine ?
Les as-tu vus dans les roseaux
Où le buffle aux larges naseaux
Dort et rumine ?
Hélas ! hélas ! tu n'as rien vu.
Ô (comme on dit) temps dépourvu
De poésie !
Ces grands chemins, sûrs nuit et jour,
Sont ennuyeux comme un amour
Sans jalousie.
Si tu t'es un peu détourné,
Tu t'es à coup sûr promené
Près de Ravenne,
Dans ce triste et charmant séjour
Où Byron noya dans l'amour
Toute sa haine.
C'est un pauvre petit cocher
Qui m'a mené sans accrocher
Jusqu'à Ferrare.
Je désire qu'il t'ait conduit.
Il n'eut pas peur, bien qu'il fît nuit ;
Le cas est rare.
Padoue est un fort bel endroit,
Où de très grands docteurs en droit
Ont fait merveille ;
Mais j'aime mieux la polenta
Qu'on mange aux bords de la Brenta
Sous une treille.
Sans doute tu l'as vue aussi,
Vivante encore, Dieu merci !
Malgré nos armes,
La pauvre vieille du Lido,
Nageant dans une goutte d'eau
Pleine de larmes.
la poète Cécile SAUVAGE, mère du musicien Olivier MESSIAEN »
Je t’aimerai encore sous terre.
Je t’aimerai de tous mes os,
Comme ici-bas je fus ta mère,
Je veillerai sur ton repos.
(…)
Ce sera la nuit maternelle
L’intime et pur enlacement
De ton enfance aux membres frêles
Lorsque tu dormais dans mon flanc
Dans un omnibus au Londres (Ezra Pound, 1915 ou 1916)
Les yeux d’une morte
M’ont salué,
Enchassés dans un visage stupide
|
Je me souviens de cette ville
Dont les paupières étaient bleues Où jamais les automobiles Ne s'arrêtent que quand il pleut Une lessive jaune et rose Y balançait au bord du ciel Où passaient des canards moroses Avec un ventre couleur miel On y a des manières d'être Qu'ailleurs on ne voit pas souvent Juste s'entrouvre une fenêtre Qu'un rideau blanc s'envole au vent Toutes les filles le dimanche S'en vont flâner au bord de l'eau Elles se gardent les mains blanches Pour attirer les matelots Le plus souvent marins d'eau douce Rencontrés sous les peupliers On voit qu'ils ne sont plus des mousses Comme ils dénouent les tabliers Tout est vraiment sans importance Un jour ou l'autre on se marie Les charpentiers dans l'existence Épousent la Vierge Marie Les hommes facilement chantent Et jurent plus facilement Quand leurs femmes se font méchantes Ils leur procurent des amants Le conjoint rentre sur le tard Avec une haleine d'anis L'épouse élève ses bâtards Et leurs héritiers réunis C'était peu après l'autre guerre |
Si vous voulez faire une tarte aux pommes à partir de rien,
il vous faudra d’abord créer l’univers. »
— Carl Sagan (*1)
 J’avais très envie, pour cette semaine sans musique, de vous parler de poésie. Quelques lignes fortes, qui marquent, qui émeuvent, peut-être l’expression la plus puissante et la plus ouverte du langage… et que l’on peut (la plupart du temps) lire en une fois. Je voulais même vous présenter une poésie différente chaque matin — et pourquoi pas simplement proposer les seuls poèmes, sans commentaires, tant l’analyse d’un poème peut le démonter, le tordre en des interprétations personnelles qui ne sont pas forcément celles des autres lecteurs.
J’avais très envie, pour cette semaine sans musique, de vous parler de poésie. Quelques lignes fortes, qui marquent, qui émeuvent, peut-être l’expression la plus puissante et la plus ouverte du langage… et que l’on peut (la plupart du temps) lire en une fois. Je voulais même vous présenter une poésie différente chaque matin — et pourquoi pas simplement proposer les seuls poèmes, sans commentaires, tant l’analyse d’un poème peut le démonter, le tordre en des interprétations personnelles qui ne sont pas forcément celles des autres lecteurs.
>>
J’ai à ce sujet eu un coup de cœur pour “Alfabet” d’Inger Christensen — et là, les choses se compliquent. Déjà (vous l’aurez remarqué), “Alfabet” d’Inger Christensen est un poème écrit en danois — et Dieu sait à quel point la poésie, plus que n’importe quelle forme de texte, est impossible à traduire fidèlement. (La seule manière de lire vraiment “Alfabet” si l’on ne maîtrise pas le danois est en version bilingue, avec une traduction en regard de l’original.) Ensuite, “Alfabet” est un long poème. Trop long pour vous le recopier en entier. Enfin, le texte complet d’“Alfabet” est à ma connaissance introuvable en ligne… et l’édition bilingue danois-français que j’ai pu lire n’a semble-t-il été imprimée qu’en 1984 (donc épuisée depuis belle lurette). Mais qu’importe ! J’avais tout de même envie de vous parler de ce texte.
Ô Versaille, ô bois, ô portiques,
Marbres vivants, berceaux antiques,
Par les dieux et les rois Elysée embelli,
A ton aspect, dans ma pensée,
Comme sur l'herbe aride une fraîche rosée,
Coule un peu de calme et d'oubli.
Poèmes (Paris, Mercure de France, 1904), Carmina Sacra (Paris, Mercure de France, 1912), Du Rhône à l'Arno (Paris, Mercure de France, 1920), De l'une à l'autre Aurore (Paris, Mercure de France, 1924).
|
Invocations d'automne
Automne merveilleux, Automne qui me dores
L'horizon de la vie encore cette fois, Toi qui, si doux, épands les feux de tes aurores Et ceux de tes couchants aux limites des bois, Mélancolique Automne, avec qui l'on voyage En des mondes de songe et de sérénité, Bel Automne pour qui, sous le dernier feuillage, Un oiseau, mais tout bas, poursuit son chant d'été, Toujours tu m'exaltas, saison harmonieuse; Ta flamme brûle encore en mes hymnes anciens : Tu m'as tout pénétré d'une ardeur sérieuse... Dis que tu le savais et que tu t'en souviens ! Pourtant, si je t'invoque aujourd'hui, cher Automne, Ce n'est pas pour revivre aux luttes du passé, Pour remettre à mon front une vaine couronne, Et rendre un peu de lustre à mon nom effacé. Que, dans l'apaisement de cet octobre, meure Ce qui n'est pas en moi le vierge attrait du Beau ; Que, la Gloire ayant fui, le seuil de ma demeure Semble à jamais le seuil délaissé d'un tombeau. Loin l'orgueil, espérant des revanches tardives! Uniquement épris d'un rêve aérien, Je ne regarde plus vers les ingrates rives Du monde aveugle et sourd, dont je n'attends plus rien. Je ne veux contempler que de pures images : Mon calme enivrement, c'est l'ampleur de tes cieux, C'est ton azur à peine offensé de nuages, Saison noble au divin rire silencieux. Ta tendresse me parle et ma ferveur t'écoute : Automne inspirateur, fais encor sous tes lois Tomber, comme un cristal, mes heures, goutte à goutte; Mets invisiblement des cordes sous mes doigts; Et que, la mélodie affluant dans mes veines, Ardente comme aux jours de ma jeune vigueur, Sans désir de frapper les oreilles humaines, Je chante seulement pour enchanter mon cœur. |
||
|
Louis Le Cardonnel. (1862-1936), Poèmes (1904).
|
||
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
O récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux!
Quel pur travail de fins éclairs consume
Maint diamant d'imperceptible écume,
Et quelle paix semble se concevoir!
Quand sur l'abîme un soleil se repose,
Ouvrages purs d'une éternelle cause,
Le Temps scintille et le Songe est savoir.
Stable trésor, temple simple à Minerve,
Masse de calme, et visible réserve,
Eau sourcilleuse, Oeil qui gardes en toi
Tant de sommeil sous un voile de flamme,
O mon silence!... Édifice dans l'âme,
Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit!
Temple du Temps, qu'un seul soupir résume,
À ce point pur je monte et m'accoutume,
Tout entouré de mon regard marin;
Et comme aux dieux mon offrande suprême,
La scintillation sereine sème
Sur l'altitude un dédain souverain.
Comme le fruit se fond en jouissance,
Comme en délice il change son absence
Dans une bouche où sa forme se meurt,
Je hume ici ma future fumée,
Et le ciel chante à l'âme consumée
Le changement des rives en rumeur.
Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change!
Après tant d'orgueil, après tant d'étrange
Oisiveté, mais pleine de pouvoir,
Je m'abandonne à ce brillant espace,
Sur les maisons des morts mon ombre passe
Qui m'apprivoise à son frêle mouvoir.
L'âme exposée aux torches du solstice,
Je te soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te tends pure à ta place première:
Regarde-toi!... Mais rendre la lumière
Suppose d'ombre une morne moitié.
O pour moi seul, à moi seul, en moi-même,
Auprès d'un coeur, aux sources du poème,
Entre le vide et l'événement pur,
J'attends l'écho de ma grandeur interne,
Amère, sombre et sonore citerne,
Sonnant dans l'âme un creux toujours futur!
Sais-tu, fausse captive des feuillages,
Golfe mangeur de ces maigres grillages,
Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,
Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,
Quel front l'attire à cette terre osseuse?
Une étincelle y pense à mes absents.
Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière,
Fragment terrestre offert à la lumière,
Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,
Composé d'or, de pierre et d'arbres sombres,
Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombres;
La mer fidèle y dort sur mes tombeaux!
Chienne splendide, écarte l'idolâtre!
Quand solitaire au sourire de pâtre,
Je pais longtemps, moutons mystérieux,
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,
Éloignes-en les prudentes colombes,
Les songes vains, les anges curieux!
Ici venu, l'avenir est paresse.
L'insecte net gratte la sécheresse;
Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air
A je ne sais quelle sévère essence...
La vie est vaste, étant ivre d'absence,
Et l'amertume est douce, et l'esprit clair.
Les morts cachés sont bien dans cette terre
Qui les réchauffe et sèche leur mystère.
Midi là-haut, Midi sans mouvement
En soi se pense et convient à soi-même...
Tête complète et parfait diadème,
Je suis en toi le secret changement.
Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!
Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes
Sont le défaut de ton grand diamant...
Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,
Un peuple vague aux racines des arbres
A pris déjà ton parti lentement.
Ils ont fondu dans une absence épaisse,
L'argile rouge a bu la blanche espèce,
Le don de vivre a passé dans les fleurs!
Où sont des morts les phrases familières,
L'art personnel, les âmes singulières?
La larve file où se formaient des pleurs.
Les cris aigus des filles chatouillées,
Les yeux, les dents, les paupières mouillées,
Le sein charmant qui joue avec le feu,
Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,
Les derniers dons, les doigts qui les défendent,
Tout va sous terre et rentre dans le jeu!
Et vous, grande âme, espérez-vous un songe
Qui n'aura plus ces couleurs de mensonge
Qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici?
Chanterez-vous quand serez vaporeuse?
Allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse,
La sainte impatience meurt aussi!
Maigre immortalité noire et dorée,
Consolatrice affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse!
Qui ne connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel!
Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous le poids de tant de pelletées,
Êtes la terre et confondez nos pas,
Le vrai rongeur, le ver irréfutable
N'est point pour vous qui dormez sous la table,
Il vit de vie, il ne me quitte pas!
Amour, peut-être, ou de moi-même haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu'importe! Il voit, il veut, il songe, il touche!
Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,
À ce vivant je vis d'appartenir!
Zénon! Cruel Zénon! Zénon d'Elée!
M'as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Le son m'enfante et la flèche me tue!
Ah! le soleil... Quelle ombre de tortue
Pour l'âme, Achille immobile à grands pas!
Non, non!... Debout! Dans l'ère successive
Brisez, mon corps, cette forme pensive!
Buvez, mon sein, la naissance du vent!
Une fraîcheur, de la mer exhalée,
Me rend mon âme... O puissance salée!
Courons à l'onde en rejaillir vivant.
Oui! Grande mer de délires douée,
Peau de panthère et chlamyde trouée,
De mille et mille idoles du soleil,
Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,
Qui te remords l'étincelante queue
Dans un tumulte au silence pareil,
Y'avait dix fill's dans un pré
Tout's les dix à marier
Y'avait Dine y'avait Chine
Y'avait Claudine et Martine
Ah! ah! Cath'rinette et Cath'rina;
Y'avait la belle Suzon,
La duchess'de Monbazon
Y'avait CéIimène
Y'avait la du Maine
Bierstube Magie allemande
Et douces comme un lait d'amandes
Mina Linda lèvres gourmandes
qui tant souhaitent d'être crues
A fredonner tout bas s'obstinent
L'air Ach du lieber Augustin
Qu'un passant siffle dans la rue
Sofienstrasse Ma mémoire
Retrouve la chambre et l'armoire
L'eau qui chante dans la bouilloire
Les phrases des coussins brodés
L'abat-jour de fausse opaline
Le Toteninsel de Boecklin
Et le peignoir de mousseline
qui s'ouvre en donnant des idées
Au plaisir prise et toujours prête
O Gaense-Liesel des défaites
Tout à coup tu tournais la tête
Et tu m'offrais comme cela
La tentation de ta nuque
Demoiselle de Sarrebrück
Qui descendais faire le truc
Pour un morceau de chocolat
Et moi pour la juger que suis-je
Pauvres bonheurs pauvres vertiges
Il s'est tant perdu de prodiges
Que je ne m'y reconnais plus
Rencontres Partances hâtives
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Comme des soleils révolus
Tout est affaire de décors
Changer de lit changer de corps
A quoi bon puisque c'est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m'éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j'ai cru trouver un pays
Coeur léger coeur changeant coeur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes jours
Que faut-il faire de mes nuits
Je n'avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
je m'endormais comme le bruit
C'était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d'épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j'y tenait mal mon rôle
C'était de n'y comprendre rien
Dans le quartier Hohenzollern
Entre la Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Tout est affaire de décor
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c'est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m'éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j'ai cru trouver un pays.
Coeur léger coeur changeant coeur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes jours
Que faut-il faire de mes nuits
Je n'avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
Je m'endormais comme le bruit.
C'était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d'épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j'y tenais mal mon rôle
C'était de n'y comprendre rien
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Comme on voit sur la branche au mois de Mai la rose
En sa belle jeunesse, en sa première fleur
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose :
La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose,
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur :
Mais battue ou de pluie, ou d’excessive ardeur,
Languissante elle meurt feuille à feuille déclose :
Ainsi en ta première et jeune nouveauté,
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté,
La Parque t’a tuée, et cendre tu reposes.
Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,
Afin que vif, et mort, ton corps ne soit que roses.
La Pythie, exhalant la flamme
De naseaux durcis par l’encens,
Haletante, ivre, hurle !... l’âme
Affreuse, et les flancs mugissants !
Pâle, profondément mordue,
Et la prunelle suspendue
Au point le plus haut de l’horreur,
Le regard qui manque à son masque
S’arrache vivant à la vasque,
À la fumée, à la fureur !
Sur le mur, son ombre démente
Où domine un démon majeur,
Parmi l’odorante tourmente
Prodigue un fantôme nageur,
De qui la transe colossale,
Rompant les aplombs de la salle,
Si la folle tarde à hennir,
Mime de noirs enthousiasmes,
Hâte les dieux, presse les spasmes
De s’achever dans l’avenir !
Cette martyre en sueurs froides,
Ses doigts sur mes doigts se crispant,
Vocifère entre les ruades
D’un trépied qu’étrangle un serpent :
— Ah ! maudite !.. Quels maux je souffre !
Toute ma nature est un gouffre !
Hélas ! Entr’ouverte aux esprits,
J’ai perdu mon propre mystère !...
Une Intelligence adultère
Exerce un corps qu’elle a compris !
Don cruel ! Maître immonde, cesse
Vite, vite, ô divin ferment,
De feindre une vaine grossesse
Dans ce pur ventre sans amant !
Fais finir cette horrible scène !
Vois de tout mon corps l’arc obscène
Tendre à se rompre pour darder,
Comme son trait le plus infâme,
Implacablement au ciel l’âme
Que mon sein ne peut plus garder !
Qui me parle, à ma place même ?
Quel écho me répond : Tu mens !
Qui m’illumine ?... Qui blasphème ?
Et qui, de ces mots écumants,
Dont les éclats hachent ma langue,
La fait brandir une harangue
Brisant la bave et les cheveux
Que mâche et trame le désordre
D’une bouche qui veut se mordre
Et se reprendre ses aveux ?
Dieu ! Je ne me connais de crime
Que d’avoir à peine vécu !...
Mais si tu me prends pour victime
Et sur l’autel d’un corps vaincu
Si tu courbes un monstre, tue
Ce monstre, et la bête abattue,
Le col tranché, le chef produit
Par les crins qui tirent les tempes,
Que cette plus pâle des lampes
Saisisse de marbre la nuit !
Alors, par cette vagabonde
Morte, errante, et lune à jamais,
Soit l’eau des mers surprise, et l’onde
Astreinte à d’éternels sommets !
Que soient les humains faits statues,
Les cœurs figés, les âmes tues,
Et par les glaces de mon œil,
Puisse un peuple de leurs paroles
Durcir en un peuple d’idoles
Muet de sottise et d’orgueil !
Eh ! Quoi !... Devenir la vipère
Dont tout le ressort de frissons
Surprend la chair que désespère
Sa multitude de tronçons !...
Reprendre une lutte insensée !...
Tourne donc plutôt ta pensée
Vers la joie enfuie, et reviens,
Ô mémoire, à cette magie
Qui ne tirait son énergie
D’autres arcanes que des tiens !
Mon cher corps... Forme préférée,
Fraîcheur par qui ne fut jamais
Aphrodite désaltérée,
Intacte nuit, tendres sommets,
Et vos partages indicibles
D’une argile en îles sensibles,
Douce matière de mon sort,
Quelle alliance nous vécûmes,
Avant que le don des écumes
Ait fait de toi ce corps de mort !
Toi, mon épaule, où l’or se joue
D’une fontaine de noirceur,
J’aimais de te joindre ma joue
Fondue à sa même douceur !...
Ou, soulevés à mes narines,
Les mains pleines de seins vivants,
Entre mes bras aux belles anses
Mon abîme a bu les immenses
Profondeurs qu’apportent les vents !
Hélas ! ô roses, toute lyre
Contient la modulation !
Un soir, de mon triste délire
Parut la constellation !
Le temple se change dans l’antre,
Et l’ouragan des songes entre
Au même ciel qui fut si beau !
Il faut gémir, il faut atteindre
Je ne sais quelle extase, et ceindre
Ma chevelure d’un lambeau !
Ils m’ont connue aux bleus stigmates
Apparus sur ma pauvre peau ;
Ils m’assoupirent d’aromates
Laineux et doux comme un troupeau ;
Ils ont, pour vivant amulette,
Touché ma gorge qui halète
Sous les ornements vipérins ;
Étourdie, ivre d’empyreumes,
Ils m’ont, au murmure des neumes,
Rendu des honneurs souterrains.
Qu’ai-je donc fait qui me condamne
Pure, à ces rites odieux ?
Une sombre carcasse d’âne
Eût bien servi de ruche aux dieux !
Mais une vierge consacrée,
Une conque neuve et nacrée
Ne doit à la divinité
Que sacrifice et que silence,
Et cette intime violence
Que se fait la virginité !
Pourquoi, Puissance Créatrice,
Auteur du mystère animal,
Dans cette vierge pour matrice,
Semer les merveilles du mal !
Sont-ce les dons que tu m’accordes ?
Crois-tu, quand se brisent les cordes,
Que le son jaillisse plus beau ?
Ton plectre a frappé sur mon torse,
Mais tu ne lui laisses la force
Que de sonner comme un tombeau !
Sois clémente, sois sans oracles !
Et de tes merveilleuses mains,
Change en caresses les miracles,
Retiens les présents surhumains !
C’est en vain que tu communiques
À nos faibles tiges, d’uniques
Commotions de ta splendeur !
L’eau tranquille est plus transparente
Que toute tempête parente
D’une confuse profondeur !
Va, la lumière la divine
N’est pas l’épouvantable éclair
Qui nous devance et nous devine
Comme un songe cruel et clair !
Il éclate !... Il va nous instruire !...
Non !... La solitude vient luire
Dans la plaie immense des airs
Où nulle pâle architecture,
Mais la déchirante rupture
Nous imprime de purs déserts !
N’allez donc, mains universelles,
Tirer de mon front orageux
Quelques suprêmes étincelles !
Les hasards font les mêmes jeux !
Le passé, l’avenir sont frères
Et par leurs visages contraire
Une seule tête pâlit
De ne voir où qu’elle regarde
Qu’une même absence hagarde
D’îles plus belles que l’oubli.
Noirs témoins de tant de lumières
Ne cherchez plus... Pleurez, mes yeux !
Ô pleurs dont les sources premières
Sont trop profondes dans les cieux !...
Jamais plus amère demande !...
Mais la prunelle la plus grande
De ténèbres se doit nourrir !...
Tenant notre race atterrée,
La distance désespérée
Nous laisse le temps de mourir !
Entends, mon âme, entends ces fleuves !
Quelles cavernes sont ici ?
Est-ce mon sang ?... Sont-ce les neuves
Rumeurs des ondes sans merci ?
Mes secrets sonnent leurs aurores !
Tristes airains, tempes sonores,
Que dites-vous de l’avenir !
Frappez, frappez, dans une roche,
Abattez l’heure la plus proche...
Mes deux natures vont s’unir !
Ô formidablement gravie,
Et sur d’effrayants échelons,
Je sens dans l’arbre de ma vie
La mort monter de mes talons !
Le long de ma ligne frileuse
Le doigt mouillé de la fileuse
Trace une atroce volonté !
Et par sanglots grimpe la crise
Jusque dans ma nuque où se brise
Une cime de volupté !
Ah ! brise les portes vivantes !
Fais craquer les vains scellements
Épais troupeau des épouvantes,
Hérissé d’étincellements !
Surgis des étables funèbres
Où te nourrissaient mes ténèbres
De leur fabuleuse foison !
Bondis, de rêves trop repue,
Ô horde épineuse et crépue,
Et viens fumer dans l’or, Toison !
*
Telle, toujours plus tourmentée,
Déraisonne, râle et rugit
La prophétesse fomentée
Par les souffles de l’or rougi.
Mais enfin le ciel se déclare !
L’oreille du pontife hilare
S’aventure vers le futur :
Une attente sainte la penche,
Car une voix nouvelle et blanche
Échappe de ce corps impur.
*
Honneur des Hommes, Saint LANGAGE,
Discours prophétique et paré,
Belles chaînes en qui s’engage
Le dieu dans la chair égaré,
Illumination, largesse !
Voici parler une Sagesse
Et sonner cette auguste Voix
Qui se connaît quand elle sonne
N’être plus la voix de personne
Tant que des ondes et des bois !