L’idée est accrocheuse et engage d’emblée le lecteur : parce que 1857 est « sans conteste un étonnant millésime » (p. 6) au cours duquel « s’exposent les grandes tensions qui structurent le champ littéraire au long du XIXe siècle » (p. 9), les articles réunis par Geneviève Sicotte se proposent de « faire l’exploration de l’imaginaire [que l’année 1857] met en jeu » (p. 7). Séduit par ce programme, le lecteur part de bon gré à la recherche de « cette entité organique de 1857 » (p. 8), il veut qu’on dirige son attention vers « le système générique, les esthétiques, la carrière des auteurs, les formes » (p. 8) et il se tarde de voir « émerger de ces analyses, en mosaïque, le tableau partiel, mais plausible de l’imaginaire littéraire de l’époque » (p. 8). Disons-le de suite : le lecteur, à l’arrivée, ne sera pas déçu, et cela malgré quelques petits écueils qui le feront d’abord voguer de Charybde en Scylla.
C’est avec précaution qu’il devra ainsi naviguer, dans les premières pages, entre certains postulats de la « Présentations » (pp. 5-12) où s’entrechoquent des propositions qui apparaissent contradictoires ; lorsqu’il s’agit de saisir les discours sociaux d’une époque, on nous rappelle, par exemple, que « la simultanéité n’engendre pas nécessairement du sens » (p. 7) ; le paragraphe suivant dit pourtant, et sans détour, que « la coexistence génère du sens » (p. 8). Or comment la « simultanéité » diffère-t-elle de la « coexistence » ?
Est-il juste, aussi, d’affirmer que la mort de Victor Hugo en 1885, ou encore celle d’Émile Zola en 1902, sont des « moments où, indépendamment de toute autre considération, le littéraire fait date » (p. 6) ? Sont-ce là des exemples purs de cette « hétéronomie des scansions politiques et littéraires » (p. 6) qui « s’accentue tout au long du siècle » (p. 6) ? Le décès d’un des plus célèbres pairs de France, le député à l’Assemblée législative qui fit le coup de feu sur les barricades de la rue Saint-Louis en juin 48, et celui de l’auteur de « J’accuse » ne furent-ils pas, au moins en partie, des événements proprement politiques ? Les cendres de ces deux « grands hommes » (dont la grandeur, justement, provient du fait qu’ils ont transcendé le littéraire pour toucher au politique) n’ont-elles pas été rapidement panthéonisées par « la patrie reconnaissante » ? La mort d’Honoré de Balzac le 18 août 1850 eut peut-être fourni, à cet égard, un meilleur exemple. À la page 19 de la revue, Stéphane Vachon rappelle justement à quel point la disparition de l’auteur de La Comédie humaine « fut pour la littérature une date, un événement » (p. 19)1.
La « Présentation » (p. 5-12) décrit également 1857 comme étant, entre autre, « l’année du manifeste sur le réalisme de Champfleury » (p. 7). S’il est vrai que Champfleury fit paraître chez Michel Lévy un ouvrage intitulé Le Réalisme, est-il exact de qualifier cette publication de « manifeste » (et l’expression est reprise au verso de la revue et encore une fois à la page 10 où l’ouvrage de Champfleury est désigné cette fois comme un « recueil-manifeste ») ? Le Réalisme fut-il vraiment un « exposé théorique lançant un mouvement littéraire », selon une des définitions classiques de ce substantif, attestée dès 1828, et donnée par Le Petit Robert de la langue française dans son édition 2007 ? À notre connaissance, le mot « manifeste » ne figure pas dans Le Réalisme et Champfleury lui-même invite son lecteur à ne pas voir son volume comme « une bible, une charte, un codex »2 sur le réalisme. Plutôt que sous sa propre plume, c’est sous celle de Gustave Courbet que Champfleury a reconnu, en juin 55, les formes d’un « manifeste réaliste » ; décrivant à « Madame Sand » le scandale que cause dans tout Paris l’exposition que Courbet inaugure, au rond-point de l’Alma, avenue Montaigne, le 28 juin 1855 et le catalogue que Courbet avait assemblé pour l’occasion, vendu 10 centimes pièce, et qui comportait un avant-propos intitulé « Le Réalisme », l’auteur de Chien-Caillou s’extasie du fait que « non content de faire bâtir un atelier, d’y accrocher des toiles, le peintre a lancé un manifeste »3; plus loin, Champfleury donne même quelques-uns des « mots excellents » que Courbet a mis « dans son manifeste »4. Et s’il fallait chercher un manifeste réaliste, n’est-ce pas chez Edmond Duranty que nous le trouverions? Qu’on se rappelle simplement le ton revendicateur avec lequel il expose les dictats de l’esthétique réaliste, en décembre 1856 par exemple, dans le second numéro du Réalisme, une revue qu’il avait lui-même fondée et qui ne verra que six parutions entre juillet 56 et mai 57 ; Duranty rappelle à ses lecteurs : « Que le Réalisme proscrivait l’historique dans la peinture, dans la peinture et dans le théâtre afin qu’il ne s’y trouvât aucun mensonge, et que l’artiste ne pût pas emprunter son intelligence aux autres. Que le Réalisme ne voulait des artistes que l’étude de leur époque. Que dans cette étude de leur époque il leur demandait de ne rien déformer, mais de conserver à chaque chose son exacte proportion. »5 Le ton, on l’entend, est doctrinaire.
Enfin, Le Réalisme de Champfleury pose une autre question quant à la pertinence de son invocation répétée dans les pages de cette réflexion consacrée à l’année 1857 : que reste-t-il, justement, de l’année 1857 dans cet ouvrage où l’auteur dit avoir « imprimé ce que j’ai pensé à diverses époques »6 ? De fait, le premier article intitulé « L’aventurier Challes » est daté de mai 1854, et la « Lettre à M. Ampère touchant la poésie populaire » est d’octobre 1853 ; le texte intitulé « Est-il bon ? Est-il méchant ? Lettre à Monsieur le Ministre d’État » date du 1er décembre 1856, et l’article sur « La littérature en Suisse » date, lui, du mois d’août 1853 ; enfin, l’avant-dernier texte du recueil, « Sur Monsieur Courbet. Lettre à Madame Sand », est de septembre 1855 (et avait d’ailleurs déjà paru dans l’édition du 2 septembre 1855 de L’Artiste, 5e série, Tome XVI, 1ère livraison, pp. 1-5.) tandis que le texte final, « Une vieille maîtresse. Lettre à M. Louis Veuillot » est de novembre 1856. L’approche synchronique, quoique fructueuse comme on le verra, n’est pas sans poser quelques problèmes de méthode7.
Le voyage en 1857 continue ensuite de fort belle manière avec l’article de Stéphane Vachon dont on peut regretter, toutefois, le titre un peu trop neutre, trop générique, « Balzac entre 1856 et 1857 » (p.13-29), un intitulé qui n’annonce pas suffisamment la thèse originale développée dans ce texte. Après cinq pages d’éphémérides, des pages vivantes où l’auteur présente, en accéléré, le film de ceux qui meurent, qui naissent, qui vivent, qui se marient, qui votent ou qui sont poursuivis en justice cette année-là, Stéphane Vachon, informe le lecteur qu’il ne s’interdira pas de déborder l’année 1857 « sur chacune de ses franges » (p. 19) et que celle-ci « constitue un moment essentiel dans l’histoire de la critique balzacienne » (p. 19) car y « foisonnent [d]es études inédites sur Balzac » (p. 20). Une retiendra particulièrement son attention : « rien d’autre, en février 1858, que la grande étude de Taine sur Balzac » (p. 26). Analysant cette étude, Stéphane Vachon montre, bousculant plusieurs idées reçues, que ce qui est en jeu dans le champ discursif littéraire de l’époque, ce ne sont pas tant les célèbres querelles entre les réalistes et les romantiques car, « hormis Pinard, Champfleury et Montalembert, personne ne sait ce qu’est le réalisme, personne n’y croit, personne n’en veut » (p. 26), mais rien de moins que « le passage du romantisme au naturalisme » (p. 26). Taine, explique Stéphane Vachon, en « naturalis[ant] Balzac » (p. 26), en reprenant, avec lui, et à son compte, la notion de « milieu » tout en s’efforçant de « saisir Balzac dans toutes ses dimensions et dans sa complexité » (p. 27), aurait créé un quelque chose comme un modèle de production littéraire, une nouvelle façon « d’expliquer les œuvres par les faits historiques et physiologiques » (p. 28), une matrice esthétique qui aura sur le jeune Zola qui, on le sait, rencontrera Taine chez Hachette, « une importance déterminante » (p. 28). Et l’auteur de conclure que cette transmission de savoirs entre Balzac et Zola, médiatisée par Taine, ce télescopage dialogique, Zola lisant Taine lisant Balzac, « invite à penser directement, autour de 1857, le […] passage […] d’une poétique de la réalité à une autre » (p. 29). On verrait bien cet article figurer, comme un contrepoint essentiel, dans plusieurs manuels d’histoire littéraire.
Dans un article intitulé « Le Réalisme de Champfleury ou la distinction des œuvres » (p. 31-43), Isabelle Daunais explique que l’auteur des Bourgeois de Molinchart, cherchant à définir « la singularité des œuvres du réalisme » (p. 33), s’est trouvé rapidement confronté à une question fondamentale : « comment discerner ce qui est une œuvre d’art de ce qui ne l’est pas ? » (p. 33) Plus encore, Isabelle Daunais s’attache à comparer les réponses avancées par Champfleury à celles proposées à la même époque par son illustre contemporain, Gustave Flaubert, qui lui aussi tentait alors de « comprendre ce que devient l’art lorsque l’artiste ne peut plus se justifier d’aucun lien avec son objet, sinon celui de la stricte observation » (p. 39). Isabelle Daunais explique que les arguments que Champfleury emploie pour identifier les tenants et les aboutissants de l’esthétique réaliste, dessinant une « vision idyllique de l’artiste » (p. 36), révèlent, au fond, son refus net de croire que l’art puisse côtoyer de si près ce qui n’est pas de l’art, « cette possibilité ouverte par le monde nouveau qu’est la dérision » (p. 40) ; en cela, Champfleury s’oppose diamétralement à Flaubert qui, « on le sait, fait de la ténuité de cette frontière l’un des paris de l’art » (p. 41), gageant d’abord que « la force du style sauvera son œuvre de l’insignifiance » (p. 41). Quoi que dise le titre de cette seconde contribution, c’est bien de la fulgurante nouveauté du réalisme flaubertien dont il est ici vraiment question ; écoutons la belle finale de cet article : « Pour l’auteur du Réalisme, 1857 ne pouvait être qu’une fin, pour celui de Madame Bovary, c’était un commencement » (p. 43).
Dans la troisième contribution, intitulée « Flaubert et la question des genres » (p. 45-58), Geneviève Sicotte montre habilement comment Flaubert a mis « systématiquement en cause les paramètres génériques de son temps » (p. 46). Si « 1857 est véritablement l’année de Madame Bovary » (p. 48), il ne faut oublier, nous dit l’auteur, que Flaubert a aussi cette, même année « un autre fer au feu » (p. 48), soit la deuxième version de La Tentation de Saint-Antoine dont des extraits seront publiés dans L’Artiste. Le fait que deux textes aussi différents « adviennent à l’existence de manière simultanée […] confère à la production de Flaubert en cette année 1857 une singulière complexité » (p.49). Avec la publication de Madame Bovary, qui place — et magistralement —, dans le champ littéraire de l’époque le genre romanesque « là où on l’attend[ait] pas » (p. 51), et celle de La Tentation de Saint-Antoine, ce texte à la « forme bâtarde » (p. 53), « hybride entre le roman et le théâtre » (p. 54), Flaubert conquiert le champ littéraire non pas en produisant de grands textes dans les formes hautement légitimées en 1857 (et l’auteur avance l’exemple du roman historique ou du roman feuilleton, p. 52, ceux, aussi, du vaudeville et du mélodrame, p. 54), mais en investissant des zones marginales du champ de production, soit les avant-gardes, « plus souples et dynamiques » (p. 56). Grâce à ce « repositionnement des genres » (p. 56), Flaubert parvient à la gloire littéraire comme « par le bas » (p. 56), en entrant par « la petite porte » (p. 56).
Dans « Le Journal des Goncourt en 1857 : le règne paradoxal de la Bohème » (p. 59-72), Anthony Glinoer demande aux frères Goncourt une « contre-expertise » (p. 63) aux analyses du phénomène socio-littéraire de la bohème faites « a posteriori » (p. 63) comme le dit l’auteur lui-même par Pierre Bourdieu d’abord dans Les règles de l’art, puis par Nathalie Heinich dans L’Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. L’auteur montre que les Goncourt ont proprement fustigé la bohème, qu’ils associent à une « gigantesque maison close » (p. 66) produisant une « littérature qui ne se montre pas digne d’elle-même » (p. 67). Les Goncourt répondront sur le plan littéraire à ce phénomène par « une pièce à faire, Les Hommes de lettres » (p. 68) et par la mise en place d’une « contre-sociabilité » (p. 69) ; ils « investissent le Café Riche » (p. 69) et forment un « cénacle » (p. 69), autant de geste, explique Anthony Glinoer, pour « élever ce que les Goncourt nomment le “capital littérateur” » (p. 67). La bohème forme donc le « camp adverse » (p. 70) et en cela, elle n’est pas « comme le déduisait Bourdieu, une matrice, mais un obstacle, ou encore un repoussoir pour les hommes de lettres » (p. 70). L’analyse des représentations de la bohème dans le Journal des Goncourt amène l’auteur à conclure que celle-ci est « l’objet d’une pluralité de discours » (p. 71) qui luttent pour « l’imposition d’une définition légitime » (p. 71) s’écartant en cela des analyses de Nathalie Heinich qui « font valoir que les représentations de la bohème […] sont multiples et que cette multiplicité est productive » (p. 71).
Jean-Pierre Bertrand, dans « La Poétique du fil : Odes funambulesques de Théodore de Banville » (p. 73-83), veut souligner la contribution de Banville à l’histoire de la poésie en cette année 1857. À cet égard, le mérite des Odes funambulesques, et celui de sa « préface-manifeste » (p. 77), fut de « transposer les techniques de la caricature dans le langage poétique » (p. 77) ce qui aura pour effet de « mettre en place un dispositif de pur langage qui conjure toute compromission avec le réel » (p. 77). Plus encore, Jean-Pierre Bertrand affirme que Banville, dans ce recueil, « invente la poésie jetable » (p. 83), une poésie moderne en ce qu’elle fait de sa situation de crise — son « nécessaire caractère éphémère » (p. 83) —, le matériau même qui la constitue. Banville touche donc ici à Flaubert, qui lui aussi approcha une forme littéraire, le roman, comme une chose qui n’allait pas de soi. Et c’est dans ces croisements inattendus que se révèle toute la qualité de ce numéro d’Études françaises qui invite à penser ensemble Banville, Flaubert, Taine, Champfleury, Zola et Balzac, à les prendre à la même époque — on a envie de dire au même coin de rue —, pour mieux entendre ce qu’il y avait de profondément harmonique dans leurs paroles imprimées.
Dans un article intitulé « Traduction négative et traduction littérale : les traducteurs de Poe en 1857 » (p. 85-98), Benoît Léger rappelle d’abord que Baudelaire ne fut pas le « seul agent de diffusion de Poe en France » (p. 89) puisqu’avant que ne paraissent les Histoires extraordinaires, on recense « au moins dix-sept traductions » (p. 90) différentes des contes du grand écrivain américain. Benoît Léger se propose ensuite de confronter les « premières lignes de […] trois nouvelles traduites à la fois par Hughes et Baudelaire » (p. 91). L’exercice, fort intéressant, révèlera que Hughes « s’inscrit dans une tradition classique de rationalisation, d’étoffement et de paraphrase » (p. 96) qui édulcore les textes de Poe tandis que les traductions de Baudelaire, plus « littéralistes » (p. 97) agissent davantage comme des « révélateur[s] » (p. 98) capables de transmettre au lecteur la « nature profonde » (p. 98) de ces Histoires extraordinaires.
Un article signé Micheline Cambron et intitulé « Pédagogie et mondanité. Autour d’une dictée… » (p. 99-110), clôt la partie thématique de la revue. L’objet du texte de Micheline Cambron est la célèbre dictée que Prosper Mérimée composa et fit passer à la cour, en 1857, suivant, selon la légende, une commande de l’impératrice (qui aurait d’ailleurs « fait 62 fautes et Napoléon III, 75 », p. 99). L’argumentation se développe en trois temps : le premier propose une rapide histoire de la dictée en France et cherche particulièrement à replacer cet exercice dans le contexte de la « pédagogie naissante » (p. 102) de l’époque. Le second mouvement du texte déplace l’analyse du côté du discours social québécois ; le corpus analysé est le millésime 1857 du Journal de l’Instruction publique. En substance on apprend que le « discours sur l’école » (p. 106) a une puissante « force d’attraction […] qui entraîne dans son mouvement quantité d’autres types de discours » (p. 106) et que, en somme, tout le discours social peut potentiellement devenir « une machine à instruire » (p. 106). Le lecteur appréciera particulièrement la troisième partie de cet article. Dans un commentaire composé finement mené, l’auteure analyse ligne par ligne la dictée de Mérimée. L’analyse révèle tout le savoir historique, géographique, sociologique et littéraire à l’œuvre dans les trois paragraphes de Mérimée ; au-delà des questions d’orthographe et d’épellation, ce texte parle surtout « de pouvoir — celui de l’église l’emporte sur les valeurs bourgeoises » (p. 110), et « d’argent » (p. 110). Non, une dictée n’est jamais sociologiquement neutre.
Il y aurait encore tant de points de l’année 1857 à explorer, se dit-on, au sortir de cet ouvrage (le discours philosophique, le théâtre, la presse, notamment) ; on voudrait aussi explorer davantage un des conflits majeurs qui traversent le champ littéraire de cette année-là et qu’on entend gronder en arrière-plan dans la plupart des articles rassemblés ici par Geneviève Sicotte : la lutte pour la légitimité littéraire qui oppose le vers à la prose ; entre Flaubert qui prépare Madame Bovary en jurant contre cette « chienne de chose que la prose » et à laquelle il veut donner « la consistance du vers »8, Champfleury qui défend le « prosaïsme » mais étudie aussi « la poésie populaire », et Baudelaire qui travaillait, dès 55, à des textes qu’il joindra plus tard à ses Petits poèmes en prose, cette opposition est structurante dans le discours de l’époque. Aussi le lecteur appellera de ses vœux une suite prochaine à ce très bon numéro d’Études françaises (un second numéro ? un colloque ?).
En plus de la partie thématique consacrée à l’année 1857, le lecteur trouvera deux autres articles dans une section intitulée « Exercices de lecture ».
Le premier, signé par Frédérique Arroyas, intitulé « Les Variations Goldberg de Nancy Huston ou la désacralisation de l’œuvre musicale » (p. 113-135), veut montrer comment ce roman polyphonique de Nancy Huston récuse de part en part « une conception de la musique comme art sublime et désincarné » (p. 135). C’est avec tout le corps que s’écoute la musique de Jean-Sébastien Bach.
Le second texte, signé par Antoine P. Boisclair et intitulé « Présence et absence du portrait à l’École littéraire de Montréal. Les exemples de Charles Gill et d’Émile Nelligan » (p. 137-151), s’attachent à montrer « qu’en s’intéressant à peinture, Gill et Nelligan [ont ouvert] la voie au poème-paysage » (p. 150), et ont favorisé la venue, dans les beaux-arts québécois de « l’esprit de composition propre aux poétiques du paysage » (p. 150).
Publié sur Acta le 21 janvier 2008
 page 64:"J'ai acheté un Mallarmé rue Gay-Lussac[...]"
page 64:"J'ai acheté un Mallarmé rue Gay-Lussac[...]"


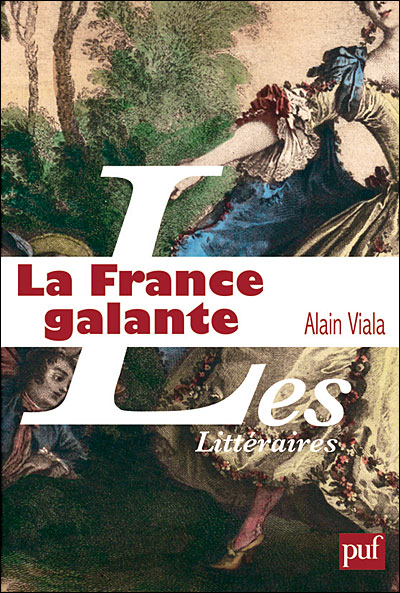

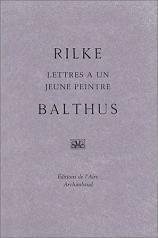


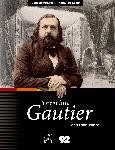


 'intellectuel à Auschwitz" : c'est ainsi qu'on présentait Jean Améry depuis la publication, en 1966, de Par-delà le crime et le châtiment, essai fondateur pour surmonter l'insurmontable. Dix ans plus tard, son Traité sur le suicide, qui défendait la mort volontaire comme un droit inaliénable, connaissait lui aussi un retentissement considérable. Mais qui était Jean Améry ?
'intellectuel à Auschwitz" : c'est ainsi qu'on présentait Jean Améry depuis la publication, en 1966, de Par-delà le crime et le châtiment, essai fondateur pour surmonter l'insurmontable. Dix ans plus tard, son Traité sur le suicide, qui défendait la mort volontaire comme un droit inaliénable, connaissait lui aussi un retentissement considérable. Mais qui était Jean Améry ?  uoiqu'il paraisse dans la collection "Grands détectives", ce roman n'est pas un policier. Pourtant on y voit apparaître, sinon à proprement parler le fantôme de Sherlock Holmes, du moins son corps astral révélé par une séance de spiritisme. Heureux clin d'oeil : on n'ignore pas que le père du détective de Baker Street, Arthur Conan Doyle, s'est converti à la fin de sa vie à la cause spirite...
uoiqu'il paraisse dans la collection "Grands détectives", ce roman n'est pas un policier. Pourtant on y voit apparaître, sinon à proprement parler le fantôme de Sherlock Holmes, du moins son corps astral révélé par une séance de spiritisme. Heureux clin d'oeil : on n'ignore pas que le père du détective de Baker Street, Arthur Conan Doyle, s'est converti à la fin de sa vie à la cause spirite...