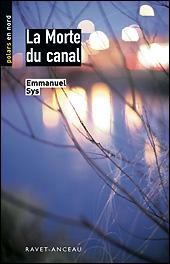Ce que révèle la correspondance des écrivains

par Jean Montenot
Lire, juillet 2007
Genre littéraire aux contours mal définis, l'échange épistolaire nous renseigne sur l'écrivain, ses petits travers et ses grands soucis. Mais il permet aussi de donner un éclairage à une oeuvre et d'entrer dans l'intime d'une pensée et d'une création.
Faut-il lire la correspondance de ses écrivains de prédilection? A quoi bon s'attacher à des textes qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas destinés à être lus comme des textes littéraires? Est-il utile, pour apprécier La comédie humaine, de pénétrer dans l'intimité de l'homme Balzac, de le voir quotidiennement obsédé par les questions d'argent? Pourtant auteur de l'une des plus intéressantes correspondances d'écrivains, Flaubert en doute. Tandis qu'il achève la lecture de la correspondance de Balzac, qui venait alors de paraître (1876), il ne cache pas sa déception à sa nièce Caroline: «Comme il s'inquiète peu de l'Art! [...] que d'étroitesses! légitimiste, catholique [...] rêvant de la députation [...]. Avec tout cela ignorant comme un pot et provincial jusque dans les moelles: le luxe l'épate.» La correspondance des écrivains n'est-elle donc que de la «paralittérature», riche, au mieux, de copeaux d'oe; uvres qui, seules, méritent de retenir l'attention? De «l'hypertexte privé», comme l'enseignent, dans leur jargon savant, nos universitaires? Et peut-on mettre sur un même plan les correspondances qui relèvent du «gribouillage imbécile» et de «l'inondation du bavardage humain» (Barbey d'Aurevilly), et celles qui, telles certaines lettres de Flaubert, fourmillent d'indications précieuses sur les sentiments profonds de l'homme ou sur les intentions de l'écrivain au moment de la gestation de ses oe; uvres?
Le paradoxe de l'épistolier
«Le meilleur de nous n'est pas destiné au papier à lettres», affirmait sans ambages Mallarmé qui admettait «crayonner» ses lettres «le plus salement possible pour en dégoûter [ses] amis». Pour celui qui professe que «le monde est fait pour aboutir à un beau livre1», on n'est écrivain que lorsqu'on fait oe; uvre littéraire. Le sacerdoce de l'homme de lettres exige de ne pas mêler l'eau pure de la littérature à l'eau trouble des missives qui charrient pêle-mêle les alluvions de l' «universel reportage» et les confidences privées. Mais aux yeux du plus grand nombre, un écrivain ne cesse pas forcément de l'être lorsque, au lieu d'écrire pour la postérité, il s'adresse à ses contemporains. Il y a cependant une différence notable de situation entre l'écrivain et l'auteur de lettres. Amis, rivaux, parents, amants, créanciers, éditeurs, critiques, hommes politiques, etc., les destinataires d'une correspondance ont ceci de particulier qu'ils peuvent exercer une influence sur la vie de l'écrivain, ce qui n'est pas sans effet sur la manière dont il leur exprime (ou leur dissimule) sa pensée. C'est cette situation paradoxale de l'écrivain épistolier qui confère à la lettre son statut d'objet singulier dans le monde des Lettres. Il y a certes des lettres qui tiennent du monologue ou qui s'apparentent au journal intime, faisant parfois office de journal de bord de l'oe; uvre littéraire. Ces lettres peuvent être lues en faisant abstraction du contexte de leur rédaction et sans le secours de présentation critique, le destinataire y est d'ailleurs réduit au rang de simple faire-valoir. Mais, dans l'ensemble très varié de la correspondance des écrivains, ces lettres forment plutôt l'exception que la règle.
Le genre épistolaire est à vrai dire un genre protéiforme, et la lettre, un objet difficilement identifiable du point de vue littéraire. Longues missives ou courts billets, les lettres sont privées ou publiques, confidentielles ou ouvertes, censées exprimer l'intime ou destinées à exercer une action sur le monde, fagotées à sauts et gambades ou rédigées dans les règles de l'art. «Chose si multiple, et variant presque à l'infini2», lit-on chez Erasme, qui fut un grand épistolier, qu'on n'a pas fini d'en recenser les formes. La correspondance dépend en plus des aléas de sa transmission, du choix des éditeurs et, parfois, des nécessités matérielles. Ces parerga, ces «hors oe; uvre», que sont les lettres d'écrivains, se présentent ainsi souvent en extraits, dans des morceaux choisis, sans les réponses des destinataires, à sens unique pour ainsi dire. Il est vrai que personne, à part les éditeurs de ces correspondances, quelques spécialistes, érudits ou monomaniaques, ne se lancerait dans la lecture suivie de la volumineuse correspondance de Voltaire ou de Proust. Il faut l'admettre: les correspondances d'écrivains ne sont pas des oe; uvres aux contours bien délimités. Elles sont même rarement complètes. Il n'est pas rare qu'en cours d'édition, ayant retrouvé un document ou après avoir obtenu des ayants droit de l'écrivain qu'ils acceptent de publier des lettres jusqu'alors soustraites à la connaissance du public, les éditeurs de «correspondances» les incluent en cours de route dans des volumes additionnels ou des suppléments. La correspondance acquiert ainsi un statut de work in progress: avec le temps, au gré des éditions, les correspondances d'écrivains se décantent et tendent ainsi à devenir d'authentiques oe; uvres littéraires.
«J'ai de quoi faire durer les noms que je mène avec moi!»
Il s'en faut que la lettre soit une pratique récente. Il y a toujours eu des correspondances à portée, sinon à valeur, littéraire. Des lettres (probablement apocryphes) évoquaient les ennuis de Platon lors de ses séjours auprès des tyrans de Syracuse; des lettres résument l'essentiel de la doctrine d'Epicure. C'est aussi dans une correspondance que Sénèque prodigue à Lucilius ses conseils sur la manière de mener une vie conforme à la vertu. Une partie de la doctrine du Nouveau Testament est transmise sous formes d'épîtres, dont Paul, Pierre, Jacques ou Jude sont les auteurs supposés. Lettres encore (peut-être inauthentiques, certains spécialistes y voient la plume de Jean de Meung), le récit des amours malheureuses d'Héloïse et d'Abélard. Elles forment même, selon Denis de Rougemont, le «premier grand roman d'amour passion» de notre littérature. La pratique épistolaire est aussi ancienne que l'activité littéraire. Il arrive parfois que l'épistolier prenne conscience, chemin faisant, de la valeur littéraire de ses lettres. En décidant de publier leur correspondance, et d'écrire pour la postérité, Sénèque fait miroiter à Lucilius une gloire posthume: «Ce qu'Epicure a pu promettre à son ami, je le promets à toi, Lucilius. J'aurais crédit chez la postérité; j'ai de quoi faire durer les noms que je mène avec moi!» (lettre 21). Fatuité? Orgueil? En tout cas, Lucilius, qui ne semble pas avoir été un personnage de second ordre, se prend au jeu au point de reprocher à Sénèque son style relâché (lettre 75). Sénèque lui répond qu'il tient à ce que ses lettres soient écrites «sans rien de recherché, ni d'artificiel», pour donner le change, comme si le tiers lecteur devait surprendre les protagonistes de la correspondance en train de converser «en tête-à-tête, paresseusement assis ou à la promenade» (ibid.). On pourra légitimement soupçonner toute correspondance destinée à la publication d'être, comme celle de Sénèque, un peu factice, et la spontanéité de l'épistolier, tributaire des astuces de l'écrivain. Nombre de «lettres» ont ainsi été écrites, par-delà leur destinataire déclaré, pour d'autres lecteurs. Paradoxalement, le mode de l'adresse personnelle permet de toucher le plus grand nombre. Que la lettre ait été, avec le sermon, le genre littéraire dominant au Moyen Age n'est donc qu'un paradoxe apparent: ces deux formes d'expression sont en fait complémentaires et répondent à des codes d'écriture assez contraignants.
Une affaire de femmes?
Un autre poncif veut que la correspondance soit un genre d'écriture féminin. On sait qu'à l'âge classique on répugne à s'étendre sur le «moi haïssable». L'esprit, quand il s'attarde sur soi, est toujours un peu la dupe des sentiments, et la pudeur et la bienséance s'opposent à l'étalage des intermittences du coe; ur. Les correspondances privées sont ainsi perçues comme un genre d'écrit spécifiquement féminin, genre secondaire, où l'esprit de spontanéité et la délicatesse naturelle des femmes trouvent un espace propice à leur épanouissement. Le jugement de La Bruyère fait alors autorité: «Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. Elles trouvent sous leur plume des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche» (Les caractères). Un préjugé tenace: «Genre épistolaire: genre exclusivement réservé aux femmes», écrit encore Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues. Les lettres de Mme de Sévigné forment, il est vrai, l'archétype de l'écriture privée devenue littérature. Mais si Mme de Sévigné accède à la gloire littéraire en tant qu'épistolière - ses lettres étaient lues en petit comité d'ami(e) s - la correspondance demeure en fait une pratique essentiellement masculine. Voiture, Guez de Balzac et Chapelain doivent leur (relative) consécration littéraire à l'édition de leur correspondance. Et qui veut connaître le fond de la pensée cartésienne en matière de morale se doit de lire les lettres de Descartes à la princesse Elisabeth. Le même Descartes avait d'ailleurs bien conscience de l'importance de sa correspondance «privée». Pour la diffusion de sa pensée, son ami, le père Marin Mersenne, faisait ainsi à la fois figure de correspondant privilégié, de «boîte aux lettres» et d'attaché de presse avant la lettre. Les provinciales, dans un tout autre registre il est vrai, participent aussi du genre épistolaire: on ne saurait donc cantonner la correspondance à l'expression des sentiments délicats, encore moins en faire un genre proprement féminin.
Le roman épistolaire et l'âge d'or de la correspondance
Plus soutenable, l'idée que la correspondance offre à l'écrivain un espace d'expression de ses sentiments plus authentique, plus libre. Et sans doute n'est-ce pas un hasard si le siècle des Lumières, qui voit réhabiliter l'expression littéraire des sentiments privés - le «charmant projet» qu'a eu Montaigne de se peindre, écrit Voltaire en réponse à Pascal - est aussi celui de l'âge d'or de la correspondance littéraire. Les lettres des uns et des autres sont lues dans les salons. L'un des signes notables du phénomène est le développement d'une mode, ou plutôt d'un procédé nouveau: le roman épistolaire. A l'origine de cette mode: le succès des Lettres portugaises, attribuées à une religieuse portugaise, parues anonymement en 1669 et dont l'auteur, Guilleragues, n'était ni religieuse ni portugaise. La fiction épistolaire connaît alors sa moisson de chefs-d'oe; uvre, avec les Lettres persanes (1721) de Montesquieu, les Lettres philosophiques (1734) de Voltaire, plus tard La nouvelle Héloïse (1761) de J.-J. Rousseau ou Les liaisons dangereuses (1782) de Choderlos de Laclos. Cette littérature épistolaire ne relève bien sûr pas stricto sensu de la correspondance d'écrivains, mais, par une sorte d'effet de miroir, elle atteste l'estime dans laquelle est désormais tenue la forme de la lettre. La mode du roman par lettres a passé, mais la lettre, comme mode privilégié d'expression des sentiments intimes, a fait son entrée en littérature et, à partir de l'époque romantique, elle devient complémentaire du journal intime. Les écrivains prennent à témoin certains de leurs correspondants des tâtonnements et des impasses de leur création. Lorsque l'échange se fait entre deux écrivains dont les options esthétiques sont divergentes, cela donne au lecteur le sentiment qu'ils s'écrivent sans jamais correspondre, comme c'est le cas entre Gide et Valéry.
Une écriture pour autrui équivoque
La lettre permet à l'écrivain de s'adresser à autrui hors de sa présence, à l'abri de ses réactions immédiates. Cette distance est même, assez fréquemment, condition de la proximité. Quand on lit la correspondance de Flaubert, on sent qu'entre Louise Colet et lui il n'y a de proximité possible qu'à raison de la distance qui sépare Croisset de Paris. Mais la proximité ne veut pas dire toujours sincérité. On peut ainsi présumer que les plaintes de Flaubert accouchant de Madame Bovary avaient aussi pour but de tenir éloignée Louise Colet. Le jeu équivoque dont elle était le témoin privilégié prend fin avec une lettre de rupture qui est un modèle de sécheresse et de muflerie masculines. Les amours impossibles de Kafka se déploient aussi au rythme de correspondances où l'élue du moment n'est vraiment présente qu'à partir du moment où l'écrivain est seul et qu'il peut enfin jouir de la présence imaginée de l'autre: «Voilà, chérie, les portes sont fermées, c'est le silence et je suis de nouveau auprès de toi» (15-16 décembre 1912 à Felice Bauer). La correspondance est donc une «écriture pour autrui» paradoxale, nous informant de la psychologie des écrivains autant sinon plus que l'écriture autobiographique, consignée dans les Mémoires ou les journaux intimes.
Petits et grands travers des écrivains
Faut-il d'ailleurs croire les écrivains lorsqu'ils écrivent à leurs contemporains? Ils ne sont pas nécessairement plus sincères dans leurs correspondances que dans leurs oe; uvres ou dans leurs écrits autobiographiques. La lecture attentive des correspondances va parfois à l'encontre des images d'Epinal qui font de nos écrivains des princes désintéressés de la littérature. Il y a des correspondances qui trahissent leurs auteurs, qui nous les montrent ordinaires, humainement médiocres, mesquins, menteurs, calomniateurs voire délateurs. On songe aux échanges de lettres que ces beaux messieurs les philosophes (Hume, Grimm, Voltaire, d'Holbach, etc.) s'écrivent pour discréditer le malheureux Rousseau en fuite3. Il est vrai que les niaiseries «christicoles» de l'auteur de l'Emile allaient à l'encontre de l'entreprise politique de déchristianisation de l'Encyclopédie, et que ses vaticinations sur la justice sociale avaient le tort de mettre en cause l'idéal voltairien d'un ordre social où le «grand nombre travaille pour le petit qui le gouverne». Lorsqu'on lit la correspondance de Proust, on est surpris de voir l'écrivain, qui n'a pas son pareil pour peindre la vanité et le snobisme du monde, pris en flagrant délit de vanité ou de snobisme. On a du mal à retrouver les professions de foi du narrateur de la Recherche sur la vocation littéraire dans les circonlocutions auxquelles Proust se livre dans sa correspondance pour se faire adouber par ce que le regretté Pierre Bourdieu aurait appelé le «champ littéraire». Tacticien, Proust fait jouer la concurrence entre Fasquelle et Gallimard. Malin, il sait qu'un parfum de scandale peut constituer un argument utile pour «lancer» son oe; uvre. Sous couvert d'avertir ses éditeurs éventuels, il les «ferre» en leur révélant que le baron de Charlus «n'est pas du tout l'amant de Madame Swann, mais un pédéraste» (à Gaston Gallimard, 5 novembre 1912) - et qui pis est, un pédéraste d'un style «assez neuf» puisqu'il s'agit d'un «pédéraste viril». Ce genre de révélation servait en fait l'oe; uvre pour laquelle Proust se démenait, «comme un père pour son enfant» (à Mme Straus, 10 novembre 1912). Si la correspondance des écrivains est «à littérarité variable», moins guindée que leur production proprement littéraire, elle témoigne souvent davantage de la vraie vie, et, même lorsqu'elle est mensongère, elle mérite, à ce titre au moins, qu'on y musarde.
1) Entretien avec Jules Huret paru dans L'Echo de Paris en 1891. 2) Erasme, De conscribendis epistolis (Sur l'art de composer des lettres), 1522. 3) Henri Guillemin, Cette affaire infernale, Utovie, 2003.
Bibliographie
Marcel Proust, Lettres, Plon, 2004.
Gustave Flaubert, Correspondance, Folio, 1998.
Abélard et Héloïse, Lettres, Le Livre de poche, 2007
Descartes, Correspondance avec Elisabeth, Garnier-Flammarion, 1989.
Mme de Sévigné, Lettres, Garnier-Flammarion, 2003.
Lettres portugaises, Le Livre de poche, 2003.
Vincent Kaufmann, L'équivoque épistolaire, Minuit, 1990.

Un plaisir trop bref. Lettres
Truman Capote
10/18
Source:http://www.lire.fr/enquete.asp?idc=51360&idR=200&idG=8